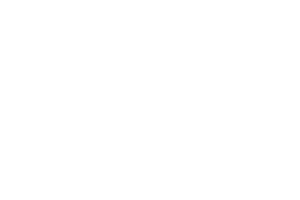Auteur: Thomas De Koninck (voire sa « fiche Wikipédia« )
Thomas De Koninck est titulaire de la Chaire La philosophie dans le monde actuel à l’Université Laval et ancien Doyen de la Faculté de philosophie. Il a été Boursier Rhodes (Oxford, 1956-1959), élu en 2002 à la Société Royale du Canada et nommé membre de l’Ordre du Canada en 2004.
Il a reçu en 2002-2003 le prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval. Ses livres incluent De la dignité humaine (1995 et 2002), couronné en 1996 par le Prix La Bruyère de l’Académie française, La nouvelle ignorance et le problème de la culture (2000), Philosophie de l’éducation. Essai sur le devenir humain (2004), Aristote, l’intelligence et Dieu (2008) et Questions ultimes (2012), qui a été primé Prix du Livre de l’Association Canadienne de Philosophie en 2013.
 Introduction
Introduction
« L’ancienne alliance est rompue ; l’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. À lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres[1]. »
Ainsi Jacques Monod exprimait-il, en conclusion de son livre célèbre Le hasard et la nécessité, un sentiment qui semble encore bien présent dans la culture ambiante. Or voici, en revanche, ce qu’écrivait Teilhard en conclusion du prologue du Phénomène humain :
« En vérité, je doute qu’il y ait pour l’être pensant de minute plus décisive que celle où, l’écaille tombant de ses yeux, il découvre qu’il n’est pas un élément perdu dans les solitudes cosmiques, mais que c’est une volonté de vivre universelle qui converge et s’hominise en lui. L’Homme, non pas centre statique du Monde — comme il s’est cru longtemps ; mais axe et flèche de l’Évolution, — ce qui est bien plus beau[2] ».
Laquelle de ces deux visions est juste ? L’émergence de l’être humain est-elle le fruit d’un hasard ? Ou obéit-elle, au contraire, à une finalité — au sens large du terme à tout le moins ? À quoi s’ajoute une autre difficulté : pour les tenants des théories de l’évolution, qu’advient-il de la création dont parle la Bible ? Ces questions tirent d’autant plus à conséquence qu’il s’agit de notre origine à toutes et à tous, voire — pour peu que nous accordions au mot « création » son sens fort — de tout ce qui est. Elles plongent de toute manière au cœur de ce que Husserl appelait magnifiquement « la lutte de l’humanité pour la compréhension de soi-même[3] ».
Le débat de fond les concernant est du reste toujours le même en ses composantes essentielles. Creation or Evolution : Do We Have to Choose ? (Création ou évolution : devons-nous choisir ?) demande un ouvrage récent[4]. La réponse à cette question me semble être que non : nous n’avons pas à choisir entre les deux, chacune ayant sa part de vérité, sans nulle contradiction. Le problème réel, ici comme ailleurs, est bien plutôt : « culture ou inculture, faut-il choisir ? », un exemple évident de l’inculture à son pire étant de lire la Bible comme s’il s’agissait d’un traité scientifique ; un autre étant, en contrepartie, le réductionnisme simplet d’un certain scientisme.
Il est à noter que, dès 1950, dans l’encyclique Humani Generis, Pie XII voyait dans « l’évolutionnisme » une « hypothèse sérieuse ». Près d’un demi-siècle plus tard, Jean-Paul II précisait que :
[d]e nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l’évolution plus qu’une hypothèse.
Il est en effet remarquable que cette théorie se soit progressivement imposée à l’esprit des chercheurs, à la suite de découvertes faites dans diverses disciplines du savoir. La convergence, nullement recherchée ou provoquée, des résultats de travaux menés indépendamment les uns des autres, constitue par elle-même un argument significatif en faveur de cette théorie.
Puis il ajoutait un peu plus loin cette remarque capitale, d’ordre épistémologique :
En outre, l’élaboration d’une théorie comme celle de l’évolution, tout en obéissant à l’exigence d’homogénéité avec les données de l’observation, emprunte certaines notions à la philosophie de la nature. Et, à vrai dire, plus que la théorie de l’évolution, il convient de parler des théories de l’évolution. Cette pluralité tient, d’une part, à la diversité des explications qui ont été proposées du mécanisme de l’évolution et, d’autre part, aux diverses philosophies auxquelles on se réfère. Il existe ainsi des lectures matérialistes et réductionnistes, et des lectures spiritualistes. Le jugement ici est de la compétence propre de la philosophie et, au-delà, de la théologie[5].
On aura pu le constater en effet, les deux jugements que j’ai cités au départ, celui de Monod et celui de Teilhard, sont en réalité d’ordre philosophique, même si Monod était un scientifique et Teilhard, un scientifique et un théologien. C’est sur ce terrain philosophique que je me situerai, tout naturellement, quitte à m’aventurer sur le terrain théologique, s’agissant de création. La réflexion que je propose se découpera en deux étapes, subdivisées elles-mêmes en deux parties, soit :
I. Théories de l’évolution :
1- Rappels ;
2- Hasard et finalité
II. Création :
1- Dieu créateur
2- L’éternité.
Théories de l’évolution
1- Rappels
Dès 1935, le Frère Marie-Victorin, grand botaniste québécois, écrivait :
La paléontologie […] nous apprend d’une façon indéniable qu’il y a eu, dans les types organiques, une succession dans le temps de telle sorte que les formes les plus complexes et les plus élevées en organisation sont apparues les dernières. À ce témoignage de la paléontologie
absolument inattaquable, vient s’ajouter l’expérience que nous avons de la continuité de la vie : nous savons que les organismes les plus simples n’apparaissent pas spontanément. Nul biologiste ne voudrait aujourd’hui nier la proposition suivante : « Aucun être vivant ne peut prendre naissance en dehors de la continuité du plasma de ses ancêtres ».
Et il ajoutait que « les différents types vivants doivent s’être développés non seulement les uns après les autres, mais les uns des autres[6] ». Or il est clair que pour expliquer cela, il faut une théorie méritant le nom de scientifique.
Comme chacun sait, une première théorie évolutionniste fut proposée par le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck, en 1809, celle de « l’hérédité des caractères acquis par l’habitude ». L’exemple traditionnellement cité est celui du long cou de la girafe. Selon cette théorie, l’allongement du cou de la girafe s’explique comme suit : ses ancêtres à cou court, ne trouvant plus de nourriture sur le sol, furent obligés de brouter aux arbres. Ce caractère, partiellement acquis durant l’existence de la girafe A, fut transmis à la girafe B, l’allongement acquis par B fut transmis à C, etc. Mais cette théorie, on le sait également, n’a jamais pu être corroborée.
Lorsqu’il publia, en 1859, L’origine des espèces, Darwin reprit l’idée lamarckienne de transformisme, mais proposa une explication causale plus complexe et plus subtile. Le nombre de descendants que génèrent les espèces est tel que si tous arrivaient à l’âge adulte, la terre en serait vite surpeuplée. Un grand nombre meurent toutefois — par hasard, dit-on. La question devenait : lesquels survivent? Réponse de Darwin: ceux qui sont les mieux adaptés à leur milieu. Parmi ces derniers, voilà que certains présentent une modification brusque due au hasard du système des caractères héréditaires et il apparaît un individu au cou plus long (pour reprendre cet exemple). Comme le résume bien Michel Delsol,
«Ce sujet se nourrit beaucoup mieux et fait disparaître les feuilles plus vite, les girafes à cou court meurent plus vite et ont moins de descendants. Dans les siècles qui suivent, une girafe au cou plus long encore apparaît peu à peu et à son tour remplace les précédentes. De génération en génération, le cou s’allonge ainsi et les animaux deviennent ceux que nous connaissons aujourd’hui. Chez Darwin, c’était donc un changement héréditaire, plus ou moins mystérieux et encore inconnu, dû au hasard, qui provoquait d’emblée l’allongement du cou. Tandis que les sujets qui ne possédaient pas cet allongement mouraient, ceux qui le possédaient survivaient et ils étaient sélectionnés. La sélection jouait donc un rôle majeur»[7].
Quelques décennies après la mort de Darwin, on devait découvrir qu’était juste l’idée – qu’il avait imaginée sans preuve — de corpuscules dotés de capacités à transmettre les caractères héréditaires. Il est vrai que le moine Gregor Mendel avait bien montré cela en 1865, mais on l’ignorait; c’est vers 1910 que ses expériences ont été redécouvertes; de là vient l’appellation «lois de Mendel» pour désigner les lois de l’hérédité. On appela «mutations» les changements de ces corpuscules désormais dénommés gènes. On se mit à étudier à fond ces lois de l’hérédité à compter des années 1910, sous l’impulsion du généticien américain Thomas Hunt Morgan. Il s’avéra qu’elles avaient un caractère particulier, celui de posséder une structure pouvant s’exprimer en termes mathématiques. C’est donc mathématiquement qu’on a pu prouver à partir d’elles que pour qu’il y ait évolution biologique il faut une sélection.
Mais que signifie, au juste, le mot « sélection », en l’occurrence ? Au chapitre 3 de L’origine des espèces, Darwin énonce clairement que même s’il a choisi les termes « sélection naturelle », l’expression utilisée souvent par Herbert Spencer de « survival of the fittest » (« survie des plus aptes ») est « more accurate » (« possède une précision supérieure »). Il déclare également : « I should premise that I use this term [Struggle for existence] in a large and metaphorical sense[8] » (« Je ferai observer au préalable que j’utilise l’expression [Lutte pour l’Existence] en un sens large et métaphorique »). Qu’est-ce à dire ?
Julian Huxley, l’auteur, en 1942, de l’expression « théorie synthétique de l’évolution », avançait les deux énoncés contradictoires suivants, à quelques pages d’intervalle, dans un essai publié en 1959, « Man’s Place in Nature » (« La place de l’homme dans la nature ») : « Natural selection can determine the direction of change, but has no goal. It pushes evolution blindly from behind » (« La sélection naturelle peut déterminer la direction du changement, mais elle n’a pas de but. Elle pousse l’évolution aveuglément d’en arrière ») ; et, plus loin, « Natural selection is an ordering principle. It takes the disorderly material provided by “random” or “chance” variation, builds it up into orderly patterns of organization, and guides it into ordered paths of change[9] » (« La sélection naturelle est un principe d’ordre. Elle prend le matériau désordonné dû à une variation aléatoire ou à la chance, le construit en des formes d’organisation, et le guide selon des tracés ordonnés de changement »).
Qu’en est-il toutefois, justement, de la place de l’animal humain dans la nature ? Il apparaît, de prime abord, le plus démuni en forces nécessaires à la conservation. À y regarder de plus près cependant, force est de constater que les autres animaux sont «préprogrammés» à un degré infiniment plus grand que nous; ils sont d’emblée des spécialistes. Chaque espèce n’a qu’une manière de faire les choses, et s’y conformera toujours, puisque tel est son «programme», qu’il ne leur est pas possible de changer pour un autre. Dans les excellents termes de Teilhard : « L’outil se confond avec le corps, le vivant passe dans son invention ». En effet, comme l’avait déjà fait remarquer L. Cuénot,
« […] Tout ce que nous appelons phylums zoologiques ne représente pas autre chose que la transformation d’un membre ou de tout le corps en un instrument. La taupe est un instrument de fouille et le cheval un instrument de course, comme le marsouin un instrument de nage et l’oiseau un instrument de vol. Dans ces divers cas, il y une spécialité instrumentale par genre, par famille ou par ordre zoologique. […] Avec l’Homme, tout change. L’instrument devient extérieur au membre qui l’emploie ; et cette façon toute nouvelle d’agir entraîne avec soi deux conséquences qui affectent profondément l’histoire de la Vie à partir de l’Humanité : d’abord, c’est évident, un extrême accroissement de puissance (en variété et en intensité) où il est permis de chercher un des principaux facteurs expérimentaux du succès humain, ensuite, et c’est là un fait plus inattendu, une chute brusque dans la faculté apparente des organismes à évoluer […] Seul entre tous les animaux, l’Homme a la faculté de diversifier son effort sans en devenir définitivement l’esclave» [10].
En insistant sur cette « prodigieuse puissance instrumentale de l’Humanité », Teilhard fait évidemment référence à la main. Une des manières les plus originales de décrire l’utilité de la main aura été sans doute celle de Grégoire de Nysse, reprise aujourd’hui en paléontologie humaine : la main libère la bouche en vue de la parole[11]. L’idée que l’évolution a libéré la main est chère par ailleurs à Darwin et aux évolutionnistes d’une manière générale. On constate au départ la station droite, dont l’importance et la signification furent bien marquées d’abord par les anciens Grecs, notamment Platon et Aristote, mais aussi par l’antique sagesse chinoise, puis cent fois réitérées par la suite ; tous l’associent au bout du compte à notre nature intellectuelle[12] ; pour Darwin et pour la paléontologie contemporaine, la verticalisation de l’animal humain libère la main et la face, ce qui permet le développement du cerveau et la faculté de symbolisation[13]. Non pas, insiste-t-on aujourd’hui, que tel organe provoque la formation de tel autre, mais « tout le corps est solidaire » (Leroi-Gourhan)[14].
Diversement comprise et interprétée, certes, l’existence d’un lien entre la main et l’intelligence reste néanmoins tellement évidente qu’elle a fait l’unanimité tout au long de l’histoire[15]. On l’avait déjà bien entrevue chez les Présocratiques : « Anaxagore prétend que c’est parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des animaux. Ce qui est rationnel, plutôt, c’est de dire qu’il a des mains parce qu’il est le plus intelligent[16] ». Aristote explique qu’« en effet, l’être le plus intelligent est celui qui est capable de bien utiliser le plus grand nombre d’outils : or, la main semble bien être non pas un outil, mais plusieurs. Car elle est pour ainsi dire un outil qui tient lieu des autres. C’est donc à l’être capable d’acquérir le plus grand nombre de techniques que la nature a donné l’outil de loin le plus utile, la main[17] ». Elle est « l’outil des outils », « l’instrument des instruments[18] ». Même accent chez Kant, chez Hegel aussi qui écrit de la main qu’« on peut dire qu’elle est ce que l’homme fait[19] », et chez Paul Valéry : « […] cet organe extraordinaire en quoi réside presque toute la puissance de l’humanité, et par quoi elle s’oppose si curieusement à la nature, de laquelle cependant elle procède ».
C’est, en un mot, l’universalité de la main qui témoigne d’abord de son lien avec l’intelligence : ses « virtualités innombrables » qui en font l’« organe du possible », comme le dit encore Valéry, un de ces possibles parmi tant d’autres étant justement des « machines à penser » de plus en plus perfectionnées. Elle reflète l’infinité de l’esprit humain parce que ses œuvres, elles déjà, sont infinies en variété, en inventivité, en expressivité : « Comment trouver une formule pour cet appareil qui tour à tour frappe et bénit, reçoit et donne, alimente, prête serment, bat la mesure, lit chez l’aveugle, parle pour le muet, se tend vers l’ami, se dresse contre l’adversaire, et qui se fait marteau, tenaille, alphabet ? » Valéry parlait même d’une « réciprocité de services » entre la main et la pensée elle-même, ce qu’attestent les mots mêmes désignant les actes fondamentaux de l’intelligence, à commencer par celui de « saisir » (begreifen, grasp)[20]. L’activité de penser semble même se comprendre mieux par analogie, voire de concert, avec celle de la main : « L’esprit fait la main, la main fait l’esprit. Le geste qui ne crée pas, le geste sans lendemain provoque et définit l’état de conscience. Le geste qui crée exerce une action continue sur la vie intérieure » (Henri Focillon)[21]. « Penser est peut-être du même ordre que travailler à un coffre. C’est en tout cas un travail de la main » (Heidegger)[22]. « Il faut penser la main. Mais on ne peut la penser comme une chose, un étant, encore moins comme un objet. La main pense avant d’être pensée, elle est pensée, une pensée, la pensée » (Jacques Derrida)[23].
2- Le hasard et la finalité
Selon la théorie synthétique de l’évolution, l’ensemble de l’immense phénomène qui a construit le monde vivant, du procaryote primitif et de l’amibe jusqu’à l’être humain, correspond à un immense jeu de mutations dues au hasard et triées par la sélection. L’évolution s’est en effet réalisée par petites étapes où le hasard des mutations a joué le rôle de découvreur, la sélection le rôle de triage des bonnes découvertes et d’élimination des mauvaises. Cela dit, comme le précise Michel Delsol :
«On ne rappellera jamais assez que le terme hasard ne peut qualifier que la réalisation de ce qui était en puissance dans les éléments de la nature. L’acide nucléique qui a donné lieu à un nouveau type d’acide capable de faire un œil de couleur différente de celui de la population d’origine, possédait cette propriété en puissance dans la structure chimique de ses molécules. Un mutant ne fait que ce qui lui est possible. Le processus dit de hasard qui fait apparaître une mutation ne fait pas n’importe quoi. Pour prendre un exemple simple, on rappellera qu’à la roulette il y a 36 numéros et que, par conséquent, on peut jouer une infinité de fois, le 60 ne sortira jamais, car il n’est pas dans le possible. Le jeu de hasard ne peut faire ici encore que ce qui était inscrit dans les lois du système. Ici il était dans ces lois qu’il y ait 36 numéros, et non pas 60[24].
 La célèbre question de Leibniz, « Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ? » réaffirmait justement avec force sa conception du possible comme exigence de sa réalisation :
La célèbre question de Leibniz, « Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ? » réaffirmait justement avec force sa conception du possible comme exigence de sa réalisation :
Il faut reconnaître d’abord [écrivait-il], du fait qu’il existe quelque chose plutôt que rien, qu’il y a, dans les choses possibles ou dans la possibilité même, c’est-à‑dire dans l’essence, une certaine exigence d’existence […]. Tous les possibles, c’est-à-dire tout ce qui exprime une essence ou réalité possibles, tendent d’un droit égal à l’existence, en proportion de la quantité d’essence ou de réalité, c’est-à‑dire du degré de perfection qu’ils impliquent.
Il ajoutait même :
« Par-là, on comprend de la manière la plus évidente que, parmi l’infinité des combinaisons et des séries possibles, celle qui existe est celle par laquelle le maximum d’essence ou de possibilité est amené à exister[25] ».
Or il se trouve que l’évolution peut justement être décrite comme une
« immense mécanique où chaque être, comme chaque groupe nouveau, réalise au maximum tout ce que le passé lui a légué » (Michel Delsol)[26].
Si, dans l’histoire de la vie, il s’est créé des appareils dénommés yeux capables de rendre des cellules cérébrales sensibles à des rayons d’une certaine longueur d’onde, cela veut dire que la matière cosmique était capable de fabriquer ces yeux. Il est curieux de constater que Jacques Monod, par exemple, n’ait pas vu que le hasard, qui fait apparaître les mutations, ne peut pas être considéré comme créateur de nouveautés. De même, si, dans la nature, grâce à des mutations dues au hasard et à la sélection, il s’est constitué un cerveau pensant, c’est parce que ce cerveau était dans les possibilités du système de la nature. Le hasard n’aurait jamais pu réaliser ce cerveau pensant s’il n’avait pas existé dans les possibilités des propriétés de la matière, de même qu’à la roulette la boule ne se posera jamais sur le 60 car dans ce jeu le 60 n’existe pas. Le hasard désigne donc ainsi un certain mode de causalité que les philosophes ont désigné souvent par l’adjectif contingent. C’est cette contingence omniprésente dans l’évolution que désigne sommairement le mot hasard. Aristote reprochait vivement déjà à ses prédécesseurs d’avoir sous-estimé la signification du hasard et de la contingence. De même de nos jours, en tenant compte aussi bien de la physique « classique » que de la physique quantique, Karl Popper a fait une critique à la fois fort éclairante et radicale du déterminisme scientifique et du déterminisme métaphysique[27].
Le point central, c’est le fait de la réussite du vivant, de l’œil, de la main, du cerveau de l’homo sapiens, c’est aussi le fait de l’émergence de la vie du sens au terme de toute la genèse évolutive. Partant du résultat, par exemple l’œil, la main, l’adulte pensant, force est de remonter à ses conditions de possibilité, à tout ce qui concourt à la réalisation des prodiges de la nature, de manière constante et continue. Dans les termes de Teilhard, il ne s’agit donc pas de « les décrire comme elles ont été réellement, mais comme nous devons nous les représenter afin que le Monde soit vrai en ce moment pour nous : le Passé, non en soi, mais tel qu’il apparaît à un observateur placé sur le sommet avancé où nous a placés l’Évolution[28] ».
L’extraordinaire beauté de l’univers, et du monde de la vie, l’équilibre prodigieux qu’ils impliquent, sont d’autant plus étonnants quand on a pris acte de l’immense marge d’indéterminisme et de « désordre » sans lesquels ils ne seraient pas possibles. Pour reprendre les termes de Leibniz, comment comprendre ce qui existe plutôt que rien parmi l’infinité des combinaisons et des séries possibles ? Comment comprendre que celle qui existe est celle par laquelle le maximum d’essence ou de possibilité aura été amené à exister ?
Jean Ladrière l’a bien marqué, dans sa constitution même, le possible présuppose en effet le temps, « qui rend possible le possible ». Il comporte un aspect d’anticipation, une tension interne vers son devenir-réel. Le temps « réunit sans cesse le présent à ce qui l’a déjà dépassé et à ce qui s’annonce en lui. Par sa dimension de futur il ouvre un espace à l’anticipation. Et par le fait même il fonde la possibilité de la tension interne du possible, qui est rapport à sa réalisation comme péripétie toujours en suspens et toujours à venir[29] ».
L’évolution fait ainsi apparaître un type d’historicité qui n’est pas linéaire. Elle effectue une sorte d’exploration, un cheminement risqué qui n’est pas «rigidement finalisé». Ce qu’explique ainsi Ladrière:
Ce processus n’est pas rigidement finalisé. Il n’est cependant pas purement aléatoire. Il a une directionalité, qui est l’indice d’une finalité intrinsèque. Mais cette finalité ne se révèle que progressivement, comme si elle était engendrée par le processus même. Il y a dans l’évolution un phénomène de renforcement, qui donne un poids de plus en plus grand aux possibles qui répondent le mieux à des conditions intrinsèques d’optimalité et qui ainsi impose des cheminements privilégiés en lesquels on peut reconnaître des contraintes de finalisation[30].
Nous retrouvons ici l’exigence de réalisation plus forte que d’autres de certains possibles que suggérait Leibniz, en proportion du « degré de perfection qu’ils impliquent ». Mais nous retrouvons également la réalisation par chaque être de sa perfection, telle que relevée déjà par Aristote.
Les critiques qu’adresse en effet Aristote aux théories pourtant géniales d’Empédocle, lesquelles anticipent déjà les modernes théories de l’évolution, mettent cela admirablement en relief. A-t-on des yeux pour voir ou voit-on parce qu’on a des yeux ? La seconde proposition est évidente ; qu’en est-il de la première ? L’exemple d’Aristote dans sa Physique est le suivant : si les dents aiguës et aptes à couper se trouvent en avant et les molaires en arrière, peut-on se contenter de dire c’est comme cela, sans plus ? Des causes « nécessaires », d’un « automatisme » aveugle, suffisent-elles à expliquer ces faits ?
Pour Aristote, le hasard est fondamental. À vrai dire, il sert à mieux démontrer la finalité, car il est en réalité un témoin de la finalité. La seule approche valide de la finalité naturelle serait l’approche empirique que je viens d’évoquer, qui part du résultat, par exemple l’œil, la main, l’adulte pensant, pour remonter à ses conditions de possibilité réelle. La seule nécessité admissible, s’agissant de finalité, est en effet, pour Aristote, hypothétique (ou « conditionnelle »), puisque sa réalisation peut toujours être empêchée[31].
Quand nous disons que la nourriture est nécessaire […] cela veut dire qu’on ne peut pas s’en passer. C’est là une sorte de nécessité conditionnelle ; ainsi, puisqu’il faut que la hache fende, il est nécessaire qu’elle soit dure, et si elle est dure, il est nécessaire qu’elle soit en bronze ou en fer ; de même, puisque le corps est une sorte d’outil (l’ensemble, comme chaque partie, est en vue de quelque chose), il est nécessaire, pour qu’il soit cet outil, qu’il soit fait de telle manière et composé de telle manière[32].
Pareille nécessité conditionnelle n’exclut aucunement le concours du hasard ; elle l’implique au contraire souvent : pour rappeler des exemples classiques, telle espèce dans la nature ne parviendrait pas à se reproduire n’étaient certains « gaspillages » — celui des spores pour les champignons, celui de milliards de grains de pollen de pin, ou celui de millions de spermatozoïdes.
Peut-on toutefois parler de finalité, ici encore ? Les réserves qu’on éprouve à cet égard s’expliquent fort bien face aux vues simplistes de la finalité qui ont eu souvent cours[33]. Mais en même temps, le vocabulaire biologique fondamental, notamment en théorie de l’évolution, trahit un recours implicite constant à la finalité ; aussi, pour l’éminent biologiste français Pierre-Paul Grassé, « le finalisme interne du darwinisme est éclatant » ; par exemple, « la variation mutative aléatoire, du fait de sa sélection, se trouve prise dans un système qui a une indéniable finalité : le maintien de l’espèce et son adaptation, sans cesse améliorée aux conditions de milieu. Si cela n’est pas une finalité, c’est que les mots n’ont plus de sens[34] ».
« Never mind whether you are a creationist or the most hardened of Darwinians [écrit excellemment David Sedley] : you cannot avoid saying that the heart is for pumping blood, the eyelid for protecting the eye, the teeth for cutting and grinding food […] : adequate non-teleological explanations of the parts of the eye are simply not available[35] »
« Que vous soyez un créationniste ou le plus endurci des darwiniens, vous ne pouvez éviter de dire que le cœur est pour pomper le sang, la paupière pour protéger l’œil, les dents pour couper et broyer la nourriture […] : des explications non téléologiques adéquates des parties de l’œil ne se trouvent tout simplement point ».
Qu’est-ce que la « chance » ? Qu’est-ce que la « malchance » ? Ces termes impliquent un bien ou un mal, et sont donc de part en part « finalistes », tout l’être du bien étant d’être désiré. Le « manque » manifeste inéluctablement son opposé et le présuppose, comme la cécité la vue, ou la maladie la santé ; c’est ce que déjà Héraclite sut faire voir de manière exemplaire en parlant d’« unité » des contraires. Plus on insistera sur la présence d’entités négatives — vide quantique, trous noirs, antiparticules, chaos, hasard, et le reste — mieux on marquera du même coup la présence simultanée de leurs opposés.
Reste à rendre compte de l’ensemble des causes, déterminées et indéterminées, qui concourent à la réalisation des prodiges de la nature, de manière constante et continue. Les théories de l’évolution, si elles sont vraies, ne peuvent qu’accroître l’émerveillement devant ces résultats. L’extraordinaire beauté de l’univers, et du monde de la vie, l’équilibre prodigieux qu’ils impliquent, sont d’autant plus étonnants quand on a pris acte de l’immense marge d’indéterminisme et de « désordre » sans lesquels ils ne seraient pas possibles. Ils laissent pressentir qu’en dernière analyse seul donne sens un ordre de causalité qui transcende à la fois l’indéterminisme et le déterminisme.
La création
1- Dieu créateur
De quoi s’agit-il ? Dans le cadre de la présente réflexion, ce mot « création » nous renvoie à la première page de la Bible :
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » (Gn 1,1).
Il désigne l’acte créateur de Dieu comme le commencement souverain que Dieu pose à tout ce qui existe. Notre commencement temporel se situe, pour chacune et chacun de nous, à tant d’années, à savoir celles de notre âge. L’existence de l’univers a commencé, elle, il y a environ quatorze milliards d’années, croit-on. L’acte créateur de Dieu n’est pas dans le temps, puisqu’il crée tout, y inclus le temps lui-même. Il est, de fait, éternel, si bien que la création se fait maintenant, dans le maintenant de Dieu. Rien ne s’est fait soi-même, à commencer par l’être lui-même, ni non plus le maintien de tout dans l’être, sans lequel tout retomberait dans le néant.
Qu’est-ce à dire ? Comment comprendre cela ? Saint Augustin pose la question dans les termes que voici. Peut-il y avoir un temps avant le temps, un temps où le temps n’était pas, peut-il y avoir un temps après le temps, un temps où le temps ne sera plus ? La réponse est évidemment non :
Dire : il y avait un temps quand aucun temps n’était, c’est aussi absurde que de dire : il y avait un homme quand aucun homme n’existait ; ou bien : ce monde était quand ce monde n’était pas. S’il s’agit de deux hommes distincts, nous pouvons dire : celui-ci existait quand cet autre n’existait pas. De même donc nous pouvons dire : ce temps existait quand cet autre temps n’existait pas ; mais dire : il y avait un temps quand aucun temps n’existait, c’est la dernière des folies[36].
Toutefois, que peuvent bien dès lors vouloir dire des expressions comme « avant le temps », ou « avant la création », ou « la fin des temps » ? Qui voudrait contester la remarque suivante d’Aristote, en sa Métaphysique : « […] il ne pourrait y avoir ni l’avant, ni l’après, si le temps n’existait pas » (Lambda, 6, 1071 b 8-9) — à condition, certes, que les mots « avant et après » soient pris en leur sens premier ? Mais alors, si « avant le temps » est impossible, comment peut-on parler de manière sensée de l’« origine » de toutes choses, y inclus du temps lui-même ? Le temps peut-il débuter sans un « avant » qui l’obligerait à se précéder lui-même de manière absurde — à l’intérieur de lui-même, de surcroît ? Il saute aux yeux, en d’autres termes, qu’une telle origine ne pourrait le précéder que selon quelque autre sens de « précéder ». Mais que pourrait bien être cet autre sens, et comment cela pourrait-il être ? Le temps peut-il jamais cesser ? Comment peut-il y avoir une « dernière syllabe » du temps, sans quelque chose qui soit au-delà de lui et d’une autre nature ? La seule autre possibilité ne serait-elle pas un temps sempiternel, c’est-à-dire un temps qui a toujours existé, sans commencement, et qui existera toujours, sans fin ?
La réponse d’Augustin est bien connue :
Ce n’est pas [écrit-il, s’adressant à Dieu] selon le temps que tu précèdes les temps ; autrement, tu ne précéderais pas tous les temps. Mais tu précèdes tous les temps passés selon la hauteur de ton éternité toujours présente. Et tu surpasses tous les temps futurs, parce qu’ils sont futurs et qu’une fois venus ils seront passés, tandis que toi, tu es identique à toi-même, et tes années ne s’évanouiront pas [Ps 101,28]. Tes années ni ne vont ni ne viennent ; les nôtres vont et viennent pour que toutes puissent venir. Tes années subsistent toutes simultanément, parce qu’elles subsistent ; elles ne vont pas, chassées par celles qui viennent, puisqu’elles ne s’en vont pas. Mais les nôtres ne seront toutes que lorsque toutes auront cessé d’être. Tes années sont un jour unique [Ps 89,4 ; 2 P 3,8], et ton jour n’est pas le jour quotidien, mais « l’aujourd’hui » parce que ton « aujourd’hui » ne cède pas la place à un « demain », car il ne succède pas non plus à un « hier ». Ton « aujourd’hui », c’est l’éternité. […] Tous les temps, c’est toi qui les as faits et avant tous les temps toi tu es ; et il n’y a pas eu de temps quelconque où le temps n’était pas[37].
La plupart des physiciens accordent aujourd’hui que l’univers a commencé par un point infiniment dense de pure énergie. On suppose une explosion initiale — appelée vulgairement « Big Bang » — « occupant un dixième de millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de seconde ». La question reste cependant inéluctable : « Qu’y avait-il avant le Big Bang ? », comme l’explique fort bien l’éminent biologiste et directeur du « Human Genome Project », Francis S. Collins, dans un ouvrage remarquable[38]. Seule l’antériorité de l’éternel peut répondre à cette question.
2- L’éternité
 Cependant, qu’est-ce au juste que l’éternité ? En réalité, même s’il se définit forcément toujours par opposition au temps, le concept d’éternité a été admirablement mis au clair très tôt dans la tradition philosophique. Parménide a le premier défini l’éternité de manière rigoureuse[39] : « Ni il n’était une fois, ni il ne sera, puisqu’il est maintenant, tout entier ensemble, un, continu » (DK 28 B 8, 5-6 ; trad. Marcel Conche). « Tout entier ensemble » (homou pan) réapparaît mot à mot (homou pasa) dans le traité de Plotin, De l’éternité et du temps, Ennéades III, 7, 3, l. 37, de même qu’en la formule tota simul de la célèbre définition de Boèce (interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio : « possession tout à la fois tout entière et parfaite d’une vie sans terme » ; Consolation de la philosophie, V, 11), que saint Thomas fera sienne : l’éternité n’admet pas de succession, puisqu’elle est d’un seul tenant, tout à la fois, parfaite, ne manquant de rien[40].
Cependant, qu’est-ce au juste que l’éternité ? En réalité, même s’il se définit forcément toujours par opposition au temps, le concept d’éternité a été admirablement mis au clair très tôt dans la tradition philosophique. Parménide a le premier défini l’éternité de manière rigoureuse[39] : « Ni il n’était une fois, ni il ne sera, puisqu’il est maintenant, tout entier ensemble, un, continu » (DK 28 B 8, 5-6 ; trad. Marcel Conche). « Tout entier ensemble » (homou pan) réapparaît mot à mot (homou pasa) dans le traité de Plotin, De l’éternité et du temps, Ennéades III, 7, 3, l. 37, de même qu’en la formule tota simul de la célèbre définition de Boèce (interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio : « possession tout à la fois tout entière et parfaite d’une vie sans terme » ; Consolation de la philosophie, V, 11), que saint Thomas fera sienne : l’éternité n’admet pas de succession, puisqu’elle est d’un seul tenant, tout à la fois, parfaite, ne manquant de rien[40].
Être un veut vraiment dire être indivisible, comme Aristote ne laissera pas de le répéter à maintes reprises (p. ex., Métaphysique, Δ, 6, 1016 b 4-5). « Par un seul maintenant [il] emplit le toujours », dira Montaigne (Essais, II, 12). Déjà pour Parménide l’être est continu en ce sens qu’il dure dans un maintenant qui ne passe pas, car il est toujours présent. Il y a, de plus, la notion d’une « durée sans succession ». Dans une édition récente, tout à fait remarquable, du poème de Parménide, Marcel Conche renvoie à Thomas d’Aquin : aeternitas durationem quamdam significat (« l’éternité est une espèce de durée »), mais sans succession : ipsa aeternitas successione caret (« l’éternité elle-même n’offre pas de succession ») (Summa theologiae, Ia pars, q. 10, art. 1) ; de même la création exclut-elle l’idée de succession : omnis creatio absque successione est (« toute création est sans succession ») (Contra Gentiles, II, 19)
Le « maintenant » du temps est perpétuellement « autre », « différent », de manière inéluctable, qu’on ne peut pas arrêter, il court toujours, sans jamais revenir. À l’instar des eaux du fleuve d’Héraclite, le mouvement est « autre, toujours autre » (aei allos kai allos) (Aristote, Physique, IV, 219 b 9-10), et il en va de même du temps. Dans Les métamorphoses du cercle, Georges Poulet cite une belle analogie tirée de saint Thomas, qui se retrouve chez plusieurs bons auteurs, dont Dante : la simultanéité de l’éternité et du temps peut s’illustrer par la simultanéité du centre d’une circonférence et celle d’un point donné de la circonférence. Ce dernier ne coïncide avec aucun autre point de la circonférence, cependant que le centre, pourtant directement opposé à tous les points de la circonférence, coïncide avec tous. De même l’éternité coexiste-t-elle avec tous les « maintenant » du temps, cependant qu’aucun d’entre eux ne peut coexister avec les autres, en raison de la durée successive définissant le temps.
Quoi qu’il en soit, l’éternité, on l’a vu, nous apparaît comme l’autre du temps, et se définit par la négation de ce qui le caractérise, en particulier de la perpétuelle altérité du « maintenant » temporel. Ainsi que l’a fait observer à juste titre Paul Ricœur,
« il faut que je puisse nier les traits de mon expérience du temps pour percevoir celle-ci comme en défaut par rapport à ce qui la nie. C’est cette double et mutuelle négation, pour laquelle l’éternité est l’autre du temps, qui, plus que tout, intensifie l’expérience du temps[42] ».
Si saint Augustin et tous ceux qui pensent comme lui ont raison quant à l’éternité et à la création, le prodigieux déploiement du cosmos et l’évolution des espèces forcent d’autant plus l’admiration.
La théorie de l’univers en expansion oblige, de manière intéressante, à tenter de penser le commencement dans le temps ; mais il faut manifestement voir alors ce point initial plutôt comme une limite que comme un point de l’espace-temps. On est dès lors au-delà de toute représentation, puisqu’il est impossible de se représenter ce qui n’était pas. Une création dans le temps est évidemment contradictoire, puisqu’elle ne serait plus origine absolue : le contenant temps préexisterait à sa propre création. Il faut donc transcender ici toute temporalité[43].
Si Dieu existe, il est nécessairement toujours au présent, c’est-à-dire éternel. De sorte que l’instant présent est vraiment « cette équivoque où le temps et l’éternité se touchent » (Kierkegaard). Si on veut parler de création, les mots suivants de Thierry Magnin sont appropriés :
« Tout est cependant différent si chaque instant de l’univers est relié à l’éternel présent de Dieu. Dieu crée au présent. Je suis, nous sommes créés dans le présent de Dieu. Mon instant présent n’est plus si fugitif[44] ».
Telle est bien plutôt, me semble-t-il, la véritable question de l’« origine ». Dans le premier récit de la création (Gn 1,1-2,4a), l’humanité « se différencie des autres vivants qui sont “selon leur espèce” ». Elle « est placée au point stratégique de la parole et de la pensée », comme le marque avec justesse Jean-Michel Maldamé, qui ajoute que cette lecture « apporte une lumière sur la place de l’homme dans le monde des vivants et invite donc à voir l’apparition de l’homme non seulement comme un maillon parmi d’autres — au même niveau ontologique qu’eux — mais comme un achèvement, le nœud où tout s’articule. Teilhard de Chardin est un représentant qualifié de la tradition chrétienne quand il montre que l’avènement de la personne est le but du processus de l’évolution des vivants[45] ».
Je ne saurais, pour finir, passer sous silence ces autres propos lumineux de Jean-Michel Maldamé qui mettent en relief du même coup l’importance capitale du corps humain :
« La relecture du grand récit de la vie dans une lumière spécifiquement chrétienne se place ainsi sur le point le plus sensible : la chair. Contre les gnoses et les dualismes, contre les totalitarismes et les pragmatismes, contre l’hédonisme et l’arrogance, la chair reçoit une dignité infinie qui suscite les gestes d’affection, d’amour et de tendresse, de dévouement et d’accomplissement. Ainsi le maître mot inscrit dans la nature est bien celui d’amour[46] ».
La confluence ultime « vers un terme, lui-même personnel, d’unification », quel nom faut-il lui donner, demandait en effet Teilhard dans L’énergie humaine ? Réponse : « Un seul : l’Amour ».

Thomas De Koninck
Chaire « La philosophie dans le monde actuel »
Faculté de philosophie, Université Laval, Québec
Notes
[1]. Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, Seuil, 1970, p. 194-195.
[2]. Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, Paris, Seuil, 1955, p. 30 ; cf. Jacques Arnould, Teilhard de Chardin, Paris, Perrin, 2005, p. 249 sq.
[3]. Edmund Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trad. G. Granel, Paris, Gallimard, 1976, p. 19.
[4]. Denis R. Alexander, Creation or Evolution : Do We Have to Choose ?, Oxford, U.K., and Grand Rapids, Mich., 2008.
[5]. Texte de Jean-Paul II à l’Académie pontificale des sciences (1996), voir http://www.hominides.com/html/theories/jean_paul_evolution.php.
[6]. Frère Marie-Victorin, Flore Laurentienne, Montréal, Imprimerie De-la-Salle, 1935, p. 63.
[7] Michel Delsol, Darwin, le hasard et Dieu, Paris, Vrin, 2007, p. 27-28.
[8]. Charles Darwin, On the Origin of Species. A Facsimile of the First Edition, with an Introduction by Ernst Mayr, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1964, p. 62.
[9]. Julian Huxley, « Man’s Place in Nature », dans The Destiny of Man, London, Hodder and Stoughton, 1959, respectivement p. 19 et 14.
[10]. Pierre Teilhard de Chardin, La vision du passé, Paris, Seuil, 1957, p. 84-85.
[11]. Cf. Grégoire de Nysse, Traité de la création de l’homme, chap. VIII et X : « Ainsi c’est grâce à cette organisation que l’esprit, comme un musicien, produit en nous le langage et que nous devenons capables de parler. Ce privilège, jamais sans doute nous ne l’aurions, si nos lèvres devaient assurer, pour les besoins du corps, la charge pesante et pénible de la nourriture. Mais les mains ont pris sur elles cette charge et ont libéré la bouche pour le service de la parole ». Au chapitre VIII, Grégoire insiste sur le fait que ces instruments adroits qui suffisent à tout, les mains, c’est en premier lieu pour la parole que la nature les a ajoutés à notre corps. Cf. André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, tome I, Technique et langage, Paris, Albin Michel, 1964, chap. 2, en particulier p. 41 sq. et 55 sq. ; et Les racines du monde, Paris, Le Livre de Poche, 1991, p. 175 : « Ce que dit Grégoire de Nysse est très proche de ce que j’ai essayé de dire moi-même, mais à près de deux mille ans de distance, et dans une ambiance métaphysique toute différente ». Je reprends ici des propos déjà tenus ailleurs.
[12]. Cf. Platon, Timée, 90 a-b : « Cette âme nous élève au-dessus de la terre, en raison de son affinité avec le ciel, car nous sommes une plante non pas terrestre mais céleste. Et en effet c’est du côté du haut, du côté où eut lieu la naissance primitive de l’âme, que le Dieu a suspendu notre tête, qui est comme notre racine et, de la sorte, il a donné au corps tout entier la station droite » (trad. A. Rivaud) ; Aristote, Les parties des animaux, IV, 10, 686 a 25 sq. : « L’homme, au lieu des pattes et des pieds de devant, possède des bras et ce qu’on appelle les mains. Car il est le seul des animaux à se tenir droit parce que sa nature et son essence sont divines. Or, la fonction de l’être divin par excellence c’est la pensée et la sagesse. Mais cette fonction n’aurait pas été facile à remplir si la partie supérieure du corps avait pesé lourdement » (trad. P. Louis) ; cf. 687 a 6 sq. ; Herder, Idées pour une philosophie de l’histoire de l’humanité : « […] grâce à cette station verticale, l’homme devint une créature apte à créer ; il reçut des mains libres et créatrices. Et seule la station debout permet l’apparition du véritable langage humain » (cité par Kant dans son compte rendu critique : voir sa Philosophie de l’histoire, trad. S. Piobetta, Paris, Aubier, 1947, p. 101).
[13]. Cf. Charles Darwin, The Descent of Man, Part I, c. 2, New York, Modern Library, n.d., p. 431-439. Aussi, « pour l’homme, la condition vraiment fondamentale, c’est la forme de son pied » (Leroi-Gourhan, Les racines du monde, p. 176 ; voir les explications détaillées, p. 176-178, et Darwin, The Descent of Man, p. 434). Observation analogue chez Grégoire de Nysse (Traité de la création de l’homme, chap. VIII, au début). Il est intéressant de constater que le pouce du pied des anthropoïdes est opposable ; le pouce du pied humain n’est pas opposable mais plantigrade, « mécaniquement la pièce maîtresse du squelette du pied » (Leroi-Gourhan, Les racines du monde, p. 176) ; c’est donc la formation exactement inverse de celle de la main où c’est au contraire l’opposition du pouce de la main qui explique la supériorité mécanique de celle-ci, comme on sait ; or il s’agit dans les deux cas du détail principal assurant la supériorité de l’animal humain.
[14]. André Leroi-Gourhan, Les racines du monde, p. 176 ; cf. p. 170-171 : « L’outil est en quelque sorte le prolongement du corps humain, la main est la commande centrale de l’outil, et l’histoire de la main entraîne celle de tout le corps. C’est l’une des grandes vérités qu’a découvertes le dix-neuvième siècle, avec Cuvier : les parties d’un corps sont solidaires les unes des autres et on peut reconstituer avec une griffe […] les formes et les caractères physiques des animaux les plus variés, avec une surprenante exactitude […]. L’anatomie comparée est une des sciences les plus fermes et les plus convaincantes, parmi les sciences naturelles. La forme de chaque partie du corps est véritablement conditionnée par le corps tout entier ».
[15]. « Man could not have attained his present dominant position in the world without the use of his hands, which are so admirably adapted to act in obedience to his will. Sir C. Bell insists that “the hand supplies all instruments”, and by its correspondence with the intellect gives him universal dominion » (Charles Darwin, The Descent of Man, p. 434). Les observations de Darwin sont étonnamment voisines ici de celles d’Aristote dans le De Partibus Animalium ; c’est d’ailleurs dans une lettre de 1882 à W. Ogle, traducteur d’Oxford de cette œuvre d’Aristote, que Darwin formulait son éloge bien connu : « Linnaeus and Cuvier have been my two gods, though in very different ways, but they were mere schoolboys to old Aristotle » (Life and Letters, ed. F. Darwin, 3rd ed., London, John Murray, 1887, vol. 3, p. 252) ; dans le même sens, voir Georges Cuvier, Histoire des sciences naturelles depuis leur origine jusqu’à nos jours, chez tous les peuples connus, professée au Collège de France (5 volumes, 1841-1845), rédigée, annotée et publiée par Magdeleine de Saint-Agy, Paris, vol. 1, p. 132.
[16]. Aristote, De Partibus Animalium, 687 a 6-9. « Car la main, poursuit-il, est un outil; or la nature attribue toujours, comme le ferait un homme sage, chaque organe à qui est capable de s’en servir. Ce qui convient, en effet, c’est de donner des flûtes au flûtiste, plutôt que d’apprendre à jouer à qui possède des flûtes. C’est toujours le plus petit que la nature ajoute au plus grand et au plus puissant, et non pas le plus précieux et le plus grand au plus petit. Si donc cette façon de faire est préférable, si la nature réalise parmi les possibles celui qui est le meilleur, ce n’est pas parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des animaux, mais c’est parce qu’il est le plus intelligent qu’il a des mains » (ibid., 687 a 10-19).
[18]. Ibid., 687 a 21 ; cf. De anima, III, 8, 432 a 1-2. Autour du sens ici d’instrument ou d’outil, et du corps comme « instrument » et non comme une « machine », voir Gerd Haeffner, Philosophische Anthropologie, Stuttgart, Kohlhammer, 1982, § 142, p. 97 sq.
[19]. Cf. Kant, Philosophie de l’histoire, p. 62-63 ; et Anthropologie du point de vue pragmatique, trad. M. Foucault, Paris, Vrin, 1964, p. 163 ; Hegel, Phénoménologie de l’esprit, trad. J. Hyppolite, Paris, Aubier, 1939, I, p. 261 ; Encyclopédie, III, La philosophie de l’esprit (1827 et 1830), trad. B. Bourgeois, § 411 (p. 176 sq.), où la main est qualifiée d’« outil absolu » ; dans le Zusatz correspondant (p. 514-517), on lit : « La main de l’homme — cet instrument des instruments [allusion évidente à Aristote, mais tacite] — est apte à servir à une multitude infinie d’extériorisations de la volonté » (p. 515).
[20]. Cf. Paul Valéry, « Discours aux chirurgiens », dans Œuvres, I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1957 ; respectivement, p. 918, et 919 deux fois : « L’esclave enrichit son maître et ne se borne pas à lui obéir. Il suffit pour démontrer cette réciprocité de services de considérer que notre vocabulaire le plus abstrait est peuplé de termes qui sont indispensables à l’intelligence, mais qui n’ont pu lui être fournis que par les actes ou les fonctions les plus simples de la main. Mettre ; – prendre ; – saisir ; – placer ; – tenir ; – poser, et voilà : synthèse, thèse, hypothèse, supposition, compréhension… Addition se rapporte à donner, comme multiplication et complexité à plier » (ibid.).
[21]. Henri Focillon, « Éloge de la main », dans Vie des Formes, Paris, PUF, 1943; repris dans la collection « Quadrige », 1981, p. 128.
[22]. Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ?, traduit par Aloys Becker et Gérard Granel, Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 1959, p. 89-90 ; Heidegger ajoute : « La main est une chose à part. […] La main est séparée de tous les organes de préhension — les pattes, les ongles et les griffes — infiniment, c’est-à-dire par l’abîme de son être. Seul un être qui parle, c’est-à-dire pense, peut avoir une main et accomplir dans un maniement le travail de la main. […] Chaque mouvement de la main dans chacune de ses œuvres est porté par l’élément de la pensée, il se comporte dans cet élément. Toute œuvre de la main repose dans la pensée. C’est pourquoi la pensée elle-même est pour l’homme le plus simple, et partant le plus difficile travail de la main, lorsque vient l’heure où il doit être expressément accompli » (p. 90).
[23]. Jacques Derrida, « La main de Heidegger », dans Psyché, Paris, Éditions Galilée, 1987, p. 426-427; texte repris dans Heidegger et la question. De l’esprit et autres essais, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1990; le passage cité s’y retrouve à la page 190.
[24]. Michel Delsol, Darwin, le hasard et Dieu, Paris, Vrin, 2007, p. 98.
[25]. G.W.F. Leibniz, De la production originelle des choses prise à sa racine (1697), dans Opuscules philosophiques choisis, traduits du latin par Paul Schrecker, Paris, Hatier-Boivin, 1954, p. 82-92 ; repris chez Vrin, 1978, avec la même pagination ; les lignes citées sont à la page 85. Quant à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? », voir ses Principes de la nature et de la grâce fondés en raison, 1714, § 7.
[26]. Michel Delsol, « L’embryogenèse récapitule la phylogenèse. Unité et diversité du monde vivant », dans Évolution-Histoire-Philosophie, Hommage au Professeur P.P. Grassé, Paris, Masson, 1987, p. 85.
[27]. Cf. Karl Popper, L’univers irrésolu. Plaidoyer pour l’indéterminisme, trad. R. Bouveresse, Paris, Hermann, 1984. Sur le hasard et les thèmes connexes chez Aristote, voir surtout Physique, II, 3-6, 195 a 27-198 a 13 ; 8-9, 198 b 10-200 b 8 ; sur le possible et sur la contingence proprement dite, les chapitres 9 et 13 du Perihermeneias et tout le livre Θ (ΙX) de la Métaphysique sont essentiels.
[28]. Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, p. 29-30.
[29]. Jean Ladrière, « La temporalité du possible », Science et Esprit, 53, 1 (2001), p. 21-47 ; citation, p. 42.
[31]. Pour une discussion nuancée et bien informée du point de vue d’Aristote sur la nécessité et la finalité, voir encore Richard Sorabji, Necessity, Cause and Blame. Perspectives on Aristotle’s Theory, London, Duckworth, 1980, p. 143-174; voir aussi l’étude très fouillée de Monte Ransome Johnson, Aristotle on Teleology, Oxford, Clarendon Press, 2005.
[32]. Aristote, De Partibus Animalium, I, 1, 642 a 7-13, trad. J.-M. LeBlond. « La nécessité signifie donc tantôt que la fin étant telle, l’existence de certaines conditions est requise, tantôt que les choses sont ainsi et que telle est leur nature » (ibid., 642 a 32-35). Mais le développement principal à ce sujet demeure Physique, II, 8-9, 198 b 10-200 b 8.
[33]. Niels Bohr voyait toutefois dans la finalité une application du principe de complémentarité : « L’interprétation finaliste se situe dans une relation typique de complémentarité vis-à-vis de la description basée sur les lois physico-chimiques connues ou celles de la physique atomique […]. La description finaliste est elle aussi entièrement correcte. Je crois que l’évolution de la physique atomique nous a tout simplement appris que nous devons penser plus subtilement que par le passé » (d’après Heisenberg, La partie et le tout. Le monde de la physique atomique, Paris, Flammarion, 2010, p. 130-131).
[34]. Pierre-Paul Grassé, L’homme en accusation, Paris, Albin Michel, 1980, p. 23.
[35]. David Sedley, Creationism and its Critics in Antiquity, Oakland, Calif., The University of California Press, 2007, p. 168-169.
[36]. De Civitate Dei, XII, xvi, 2, trad. G. Combès, Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Bibliothèque augustinienne », 1959, p. 203. Sur « la découverte philosophique de l’éternité », voir Jan Patocka, Platon et l’Europe (1973), trad. du tchèque E. Abrams, Paris, Verdier, 1983, notamment p. 20, 78 sq., 87.
[37]. Confessions, XI, xiii (16), trad. E. Tréhorel, G. Bouissou, légèrement modifiée.
[38]. Cf. Francis S. Collins, The Language of God, New York, Free Press, 2006, p. 63 sq. Les p. 181-195 de ce livre contiennent un résumé critique fort éclairant du mouvement américain identifié sous le sigle ID, pour « Intelligent Design », initié en 1991 par Phillip Johnson, puis développé par Michael Behe et, plus récemment, William Dembski. Ce mouvement, antiévolutionniste au départ, préfère faire appel à des interventions directes du surnaturel, à intervalles réguliers, pour réparer les lacunes de la nature. Or c’est grandement sous-estimer la nature qui est d’une subtilité et adaptabilité telles qu’elle mérite bien plutôt la description qu’en fait Aristote comme d’un art inscrit dans les choses, se comparant à un médecin se soignant lui-même, selon la célèbre similitude de la Physique, II, 8, 199 b 28-33 ; « si l’art de la construction navale était dans le bois, il agirait de la même manière que la nature » (199 b 28-29 ; trad. Pellegrin). Le commentaire de Thomas d’Aquin mérite d’être cité, en l’occurrence : « […] unde patet quod natura nihil est aliud quam ratio cuiusdam artis, scilicet divinae, indita rebus, qua ipsae res moventur ad finem determinatum » (« […] d’où il est évident que la nature n’est rien d’autre qu’un certain art, c’est-à‑dire divin, inscrit dans les choses, grâce auquel les choses elles-mêmes se meuvent vers une fin déterminée ») (In II Phys., lect. 14, in fine). Cf. Plotin, V, 8 [« De la beauté intelligible »], 1. Ce qui fait exception toutefois, c’est l’origine de l’intellect, qui ne saurait provenir de la matière comme l’a fortement marqué Aristote dans son traité, De la génération des animaux, II, 3, 736 b 27-30 ; cf. 736 b 5-8 ; De anima, II, 1, 413 a 4 sq.; ainsi que III, chapitres 4 et 5.
[39]. Comme le rappelle Pierre Aubenque — qui défend à son tour, en accord avec G.E.L. Owen et contre D. O’Brien, cette interprétation, de manière du reste tout à fait convaincante —, « tous les commentateurs ont vu ici une caractérisation de l’éternité » (« Syntaxe et sémantique de l’être dans le poème de Parménide », dans Pierre Aubenque, dir., Études sur Parménide, Paris, Vrin, 1987, t. II, p. 126) ; cf. G.E.L. Owen, « Plato and Parmenides on the Timeless Present », dans Martha Nussbaum, éd., Logic, Science, and Dialectic. Collected Papers in Greek Philosophy, New York, Cornell University Press, 1986, p. 27-44 ; et Denis O’Brien, « L’être et l’éternité », dans Pierre Aubenque, dir., Études sur Parménide, p. 135-162. W.K.C. Guthrie voit avec raison dans cette reconnaissance par Parménide de l’éternel comme appartenant à « a separate category from everlasting » un « major intellectual achievement », et explique fort bien la distinction : « To conceive of something as merely everlasting [sempiternel] is to set it in time. One says that just as it is now, so it was thousands of years ago and will be in the future. But for the eternal “was” and “will be” have no meaning, and the time-sequence is abolished » (A History of Greek Philosophy, vol. II, Cambridge, Cambridge University Press, 1965, p. 29).
[40]. Cf. l’excellent commentaire de Marcel Conche, Parménide. Le Poème. Fragments, Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 1996, p. 134-140 ; et les notes précieuses de Werner Beierwaltes à sa traduction de Plotin, Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III, 7), Frankfurt, Klostermann, 1981, p. 177-178, où l’on trouve quantité de références à d’autres textes parallèles de Plotin, Porphyre et Proclus ; aussi à Boèce, saint Grégoire le Grand et saint Anselme ; il dresse en outre une liste des formules équivalentes chez Plotin et Parménide mises en regard les unes aux autres ; voir aussi, à propos du « maintenant » dans la définition de l’éternité, les p. 170-172 qui font état de nombreux lieux parallèles chez Plotin lui-même, Plutarque, Porphyre, Proclus, Ammonius, Simplicius, Olympiodore, Boèce, Gilbert de la Porrée, Albert le Grand, Thomas d’Aquin, Eckhart, Augustin et Pierre Damien.
[41]. Marcel Conche, ibid., qui fait en outre remarquer que dans ses Objections aux Méditations métaphysiques de Descartes, Arnauld décrira à son tour la durée de Dieu comme « indivisible, permanente et subsistante toute à la fois » (indivisibilis, permanens, tota simul ; « en Dieu il n’y a point de passé ni de futur, mais un continuel présent »). Descartes aussi d’ailleurs : la « durée de Dieu » (duratio Dei) est « tout à la fois tout entière » (tota simul), au contraire de la « durée successive » (duratio successiva). Pour Plotin, voir l’éternité c’est voir « une vie qui persiste dans son identité, qui est toujours présente à elle-même dans sa totalité, qui n’est pas ceci, puis cela, mais qui est une perfection indivisible. Tel un point où s’unissent toutes les lignes, sans qu’elles ne s’épandent jamais au dehors ; ce point persiste en lui-même dans son identité ; il n’éprouve aucune modification; il est toujours dans le présent, et il n’a ni passé ni futur ; il est ce qu’il est, et il l’est toujours. […] Il est ce qu’il est et ne sera pas autrement. Que lui adviendrait-il qu’il ne soit dès maintenant ? Il n’y a pas pour lui d’avenir qui ne soit déjà présent. […] Oui, ce qui est dans les limites de l’être a une vie présente tout entière [homou pasa, l’écho de Parménide que je citais : DK 28 B 8, 5 : homou pan], pleine et indivisible en tout sens ; cette vie, c’est l’éternité que nous cherchons » (Ennéade, III, 7, 3, trad. E. Bréhier). Certaines formules du De Trinitate (IV, 69-77) de Boèce, qui sont passées à la postérité, rendent bien cette constatation : nostrum « nunc » quasi currens tempus facit et sempernitatem, divinum vero « nunc » permanens neque movens sese atque consistens aeternitatem facit (« notre “maintenant” fait le temps qui court et la “sempiternité” ; cependant que le “maintenant” divin, permanent, immobile et constant, fait l’éternité »).
[42]. Paul Ricœur, Temps et récit, t. I, Paris, Seuil, 1983, p. 48, n. 3.
[43]. Cf. le numéro Cosmos et création, de la revue Communio, XIII, 3 (mai-juin 1988), en particulier les articles d’Olivier Boulnois et de Pierre Julg ; et le débat Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology, entre William Lane Craig et Quentin Smith, Oxford, Clarendon Press, 1993 ; la discussion, par Craig, de l’infini de Cantor, et sa preuve de l’impossibilité d’une existence réelle de l’infini « actuel », nous semblent particulièrement réussies (cf. p. 3-76). Voir aussi Paul Davies, God and the New Physics, New York, Simon and Schuster, 1983; The Cosmic Blueprint, New York, Simon and Schuster, 1988 ; The Mind of God, New York, Simon and Schuster, 1992 ; David Bohm, Wholeness and the Implicate Order (1980), London, New York, Ark Paperbacks, 1983, 1990 ; Every Schatzman, L’expansion de l’univers, Paris, Hachette, 1989 ; Keith Ward, Pascal’s Fire. Scientific Faith and Religious Understanding, Oxford, Oneworld Publications, 2006 ; Hans Küng, The Beginning of All Things. Science and Religion, trad. J. Bowden, Grand Rapids, Michigan ; Cambridge, U.K., Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007.
[44]. Cf. Barry Miller, From Existence to God. A Contemporary Philosophical Argument, London, New York, Routledge and Kegan Paul, 1992, p. ix-x, et 1-13 ; Le poème de Parménide, trad. J. Beaufret, Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 1955, fr. 8, p. 82 sq. ; Kierkegaard, Le concept d’angoisse, trad. K. Ferlov et J.-J. Gateau, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1969, p. 92 ; cf. p. 88-93, et la longue note sur Platon, p. 176-177 ; Thierry Magnin, Quel Dieu pour un monde scientifique ?, Paris, Nouvelle Cité, 1993, p. 70. Sur le thème du nunc stans à travers l’histoire jusqu’à nos jours, voir l’article du Historisches Wörterbuch der Philosophie (J. Ritter et al.), vol. 6, s. v. (Darmstadt, 1984).
[45]. Jean-Michel Maldamé, Création par évolution. Science, philosophie et théologie, Paris, Cerf, 2011, p. 251-252.



 Introduction
Introduction « En vérité, je doute qu’il y ait pour l’être pensant de minute plus décisive que celle où, l’écaille tombant de ses yeux, il découvre qu’il n’est pas un élément perdu dans les solitudes cosmiques, mais que c’est une volonté de vivre universelle qui converge et s’hominise en lui. L’Homme, non pas centre statique du Monde — comme il s’est cru longtemps ; mais axe et flèche de l’Évolution, — ce qui est bien plus beau
« En vérité, je doute qu’il y ait pour l’être pensant de minute plus décisive que celle où, l’écaille tombant de ses yeux, il découvre qu’il n’est pas un élément perdu dans les solitudes cosmiques, mais que c’est une volonté de vivre universelle qui converge et s’hominise en lui. L’Homme, non pas centre statique du Monde — comme il s’est cru longtemps ; mais axe et flèche de l’Évolution, — ce qui est bien plus beau absolument inattaquable, vient s’ajouter l’expérience que nous avons de la continuité de la vie : nous savons que les organismes les plus simples n’apparaissent pas spontanément. Nul biologiste ne voudrait aujourd’hui nier la proposition suivante : « Aucun être vivant ne peut prendre naissance en dehors de la continuité du plasma de ses ancêtres ».
absolument inattaquable, vient s’ajouter l’expérience que nous avons de la continuité de la vie : nous savons que les organismes les plus simples n’apparaissent pas spontanément. Nul biologiste ne voudrait aujourd’hui nier la proposition suivante : « Aucun être vivant ne peut prendre naissance en dehors de la continuité du plasma de ses ancêtres ».