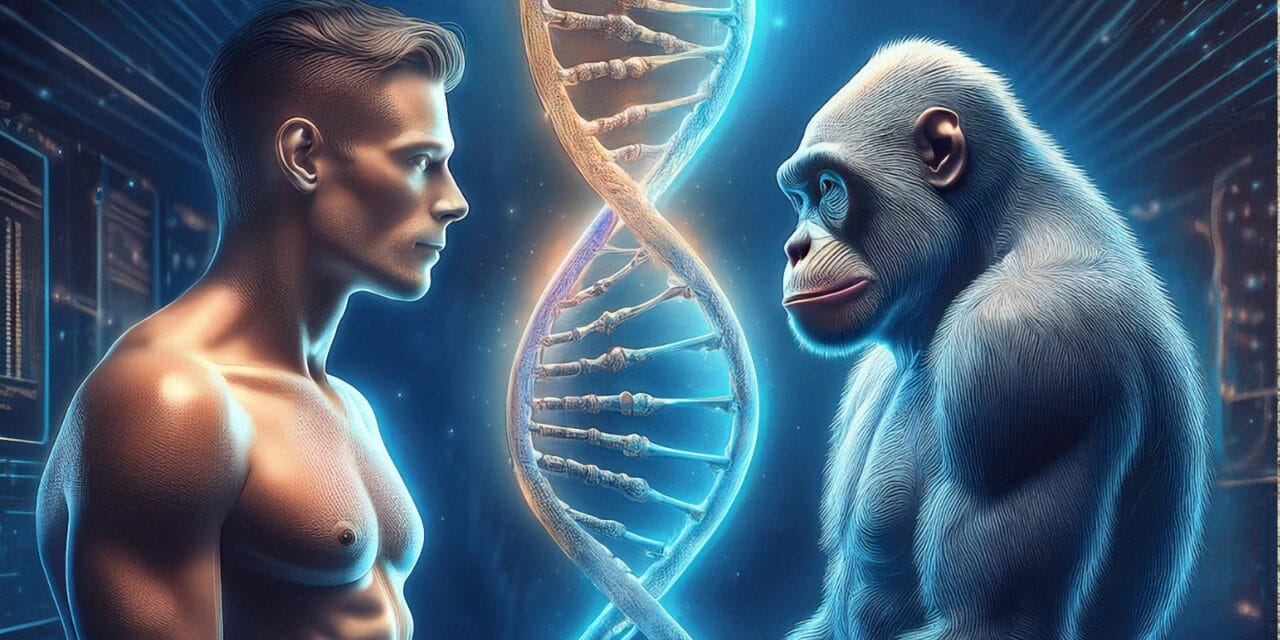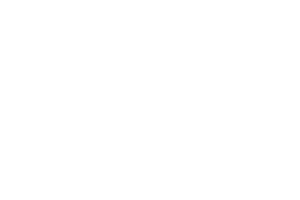illustration générée par IA
Une avancée majeure : des génomes de grands singes d’une qualité inédite
En mai 2025, la prestigieuse revue Nature a publié un article[i] décrivant les génomes de grands singes d’une qualité inégalée (plus complets, moins d’erreur) grâce aux dernières techniques de séquençage et d’analyses informatiques. Par conséquent, cette étude révèle des régions du génome inexplorées jusqu’alors, spécifiques de chacune des lignées de singes et de l’humain.
Pangénome : mieux comprendre la diversité génétique au sein des espèces
Alors oui la comparaison des génomes est rendue plus complexe, ce qui est d’ailleurs aussi attendu quand on compare les génomes d’individus d’une même espèce : il y a des différences parfois même dans le contenu en gènes entre individus, d’où la notion de pangénome qui intègre l’ensemble de ces variations au sein des espèces. Un programme de pangénome humain[ii] sur un échantillon représentatif de toute la diversité humaine est en cours.
Le chiffre de 99% de similarité entre le singe et l’humain qui circule dans les media ne concerne que les gènes (codant pour des protéines) communs aux deux espèces. Quand on considère l’ensemble de l’information génétique on est plutôt autour de 80-85% de similarité.
L’évolution humaine reste confirmée malgré la complexité génomique
Est-ce que cette complexité bouleverse l’idée que le chimpanzé est l’espèce vivante la plus proche de l’espèce humaine ? Non ! Bouleverse-t-elle l’arbre phylogénétique des grands singes ? Non plus ! Ces nouvelles données rendent-elles impossible d’estimer la date de séparation de ces deux lignées, donc celle d’un ancêtre commun ? Non, avec une date estimée à environ 6 millions d’années donc assez proche du consensus actuel.
Évolution biologique et croyances : la complexité génomique n’oppose pas science et foi
En conclusion, contrairement à la communication de certains médias aux titres chocs et raccourcis tendancieux, la complexité révélée dans cet article de la revue Nature ne met pas à mal la théorie de l’évolution biologique, et en particulier celle de l’espèce humaine. La perception que l’on peut avoir sur le caractère unique de notre espèce repose moins sur son histoire biologique que sur nos positionnements philosophiques ou théologiques. Pour ma part, elle n’enlève en rien le fait de croire que l’être humain est image de Dieu.
[i] Yoo et al (2025) Complete sequencing of ape genomes. Nature 641: 401-418, https://doi.org/10.1038/s41586-025-08816-3
[ii] Laio et al (2022) A draft human pangenome reference. Nature 617: 312-324, https://doi.org/10.1038/s41586-023-05896-x