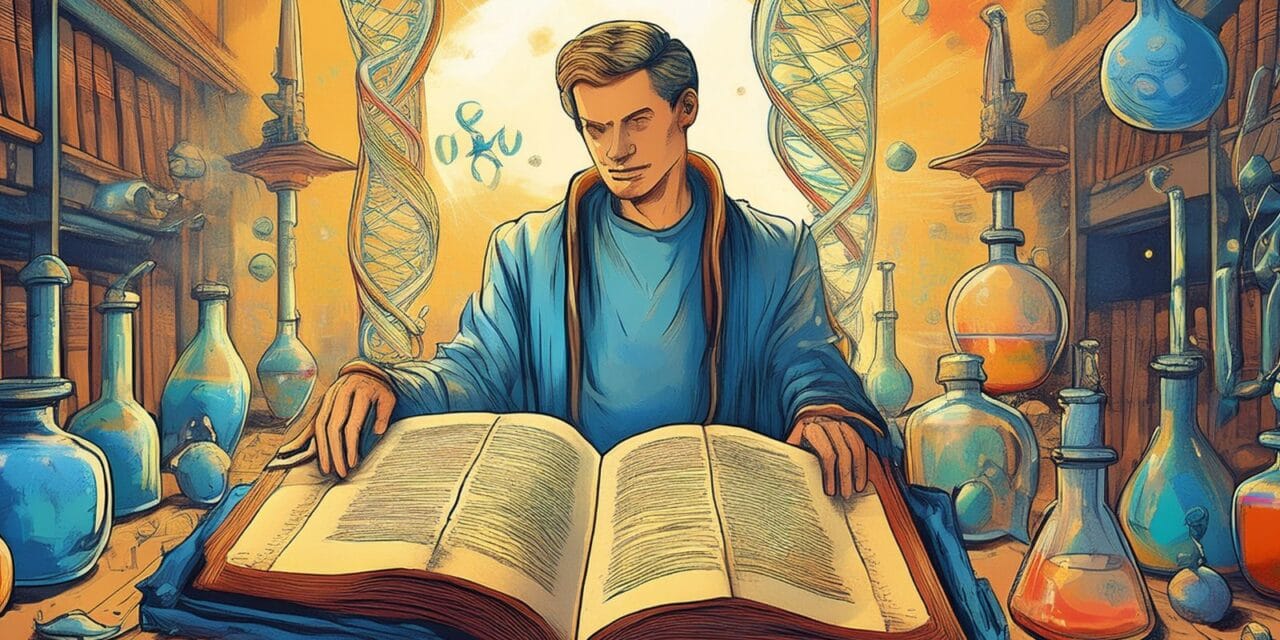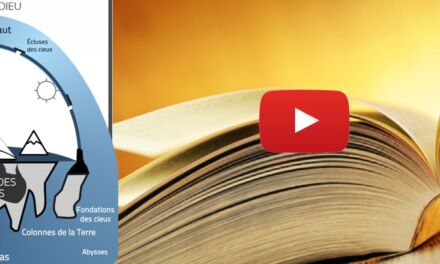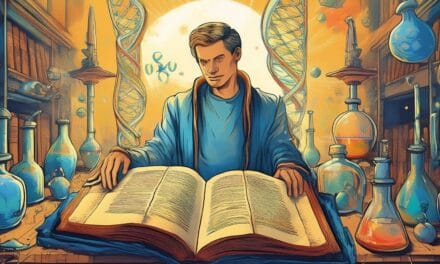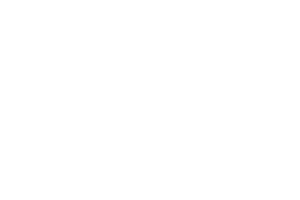Article 2 sur un total de 3 pour la série :
la Bible est-elle contre la science ? Ce que 1 Timothée 6:20 nous révèle vraiment
Bienvenue dans la deuxième étape de notre enquête ! Dans notre premier article, nous avons découvert que le mot « science » dans le fameux verset de 1 Timothée 6:20 n’avait pas le même sens qu’aujourd’hui. Nous avons appris que le grec ancien distinguait plusieurs types de « connaissance », notamment l’Epistēmē (le savoir objectif et structuré) et la Gnōsis (une connaissance plus personnelle, intime, vécue)
Aujourd’hui, armés de ces précieuses distinctions, nous allons plonger au cœur du verset pour en révéler toute la signification. Préparez-vous à démasquer l’ennemi que l’apôtre Paul combattait vraiment !
Le verset clé : Un avertissement pas si simple
Relisons attentivement le verset qui nous intéresse, 1 Timothée 6:20, et ajoutons le verset 21, car ils sont intimement liés :
« O Timothée, garde le dépôt, évite les bavardages impies et les objections d’une pseudo-science (gnosis). Pour l’avoir professée, certains se sont écartés de la foi. »
(1 Timothée 6:20-21 | TOB – Traduction Œcuménique de la Bible).
À la première lecture, le texte pourrait nous laisser croire que Timothée est invité à se méfier de ce que les modernes considèrent aujourd’hui comme de la « science ». Mais comme nous l’avons vu, le mot grec est gnōsis que certaines traductions rendent par « connaissance ». Ca sera le point central de notre étude.
Sous la loupe
Pour ne pas négliger le contexte général de ce passage, je vous propose de considérer d’abord deux étapes préliminaires avant de répondre à la question brûlante.
- Le contexte du passage dans la lettre de Paul
- La compréhension de l’idée générale en reformulant les deux versets
- Quelle est la fausse connaissance (pseudo-science) visée dans 1 Ti 6.20 ?
- Quel enseignement le croyant peut en tirer aujourd’hui encore ?
Le Contexte : Un Écho du début à la Fin de la Lettre
Un texte n’est jamais isolé. Pour bien saisir la portée de l’avertissement de Paul, il faut réaliser que les versets 20 et 21 sont la conclusion de toute sa lettre. Or, une bonne conclusion prend soin de répondre à l’introduction. Regardons ce que Paul disait à Timothée au tout début :
Selon ce que je t’ai recommandé (parakaleō) à mon départ pour la Macédoine, demeure à Ephèse pour enjoindre à certains de ne pas enseigner une autre doctrine, et de ne pas s’attacher à des légendes et à des généalogies sans fin ; cela favorise les discussions plutôt que le dessein de Dieu, qui se réalise dans la foi. Le but de cette injonction, c’est l’amour qui vient d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère. Pour s’être écartés de cette ligne, certains se sont égarés en un bavardage creux.
(1 Timothée 1:3-6 – TOB)
Vous voyez les parallèles ?
- Le « dépôt » fait écho à la « recommandation » : Au début, Paul donne une mission, une charge (parakaleō) à Timothée. À la fin, il lui demande de garder le « dépôt » (parathēkē), Bien que différentes interprétations aient été données à ce mot que l’on ne trouve que dans les épitres pastorales du Nouveau Testament[1]. On peut le comprendre comme le contenu précieux de cette mission, c’est le même trésor de la foi partagé par les apôtres qui doit être à la fois enseigné et protégé. La lettre forme une boucle parfaite.
- Les « bavardages impies » de la fin répondent aux « discussions » du début : Les « légendes » et les « généalogies sans fin » du début, qui ne produisent que des disputes inutiles, sont les mêmes que ces « bavardages impies » et les « objections » de la fin. Paul combat du début à la fin un enseignement qui perd les gens en spéculations intellectuelles au lieu de les ancrer dans l’amour et la foi.
- Le même danger de « s’égarer » : Dès le début (1:6), Paul mentionne que « quelques-uns se sont égarés » à cause de ces faux enseignements. À la fin (6:21), il conclut en constatant que ceux qui ont suivi cette « fausse gnose » se sont « écartés de la foi ». Le diagnostic est le même.
Cette structure en miroir nous confirme que Paul ne vise pas un problème général, mais une menace théologique précise et interne à la communauté, qu’il identifie dès les premières lignes de sa lettre.
Une Reformulation pour Mieux Comprendre
Parfois, pour bien saisir le sens d’un texte ancien, le mieux est de le « déplier ». Si l’on traduisait 1 Timothée 6:20-21 de manière plus littérale et enrichie, en gardant la structure du grec, cela donnerait quelque chose comme ceci :
« Ô Timothée, le trésor qui t’a été confié, garde-le ! Et pour ce faire, détourne-toi des paroles creuses et sans spiritualité, ainsi que des arguments contradictoires de ce qui est faussement appelé ‘connaissance’ (gnōsis). C’est en professant cette prétendue connaissance que certains ont manqué la cible, qui est la foi. »
Analysons cette structure :
- L’ordre principal : « Garde le dépôt ! » C’est le cœur du message.
- Comment le garder ? En évitant deux choses :
- Les » paroles creuses », c’est-à-dire les spéculations qui ne nourrissent pas la foi.
- Les « objections d’une pseudo-gnōsis« , c’est-à-dire les arguments (antithèses littéralement) d’une connaissance qui se présente comme une connaissance supérieure mais qui contredit la foi. (voir notre prochaine section).
Le verbe clé est « professer » (en grec, epaggellomai). Il ne signifie pas seulement « croire » ou « penser », mais « déclarer publiquement », « faire profession de », « s’engager dans ». C’est un acte volontaire et public. Paul dit que ceux qui choisissent activement d’adhérer à cette « gnose » et d’en faire leur étendard finissent inévitablement par « manquer la cible » ou « se détourner » de la foi authentique.
En clair, si on voulait résumer l’idée de Paul pour aujourd’hui, on pourrait dire :
« Timothée, protège ce qui t’a été confié et qui concerne la foi. Ne te laisse pas entraîner dans les débats stériles et les théories compliquées de ceux qui prétendent avoir une ‘connaissance spirituelle supérieure’. C’est une imposture. Ceux qui se sont engagés sur cette voie ont complètement perdu de vue l’essentiel : une relation de confiance simple et sincère avec Dieu. »
Pourquoi la Gnōsis et non l’Epistēmē ?
Venons en maintenant au cœur de notre sujet. Pourquoi Paul parle-t-il ici d’une pseudo-gnōsis et pas d’une pseudo- epistēmē ?
C’est LA question cruciale. Si Paul avait voulu mettre en garde Timothée contre la logique, la philosophie ou ce que les Grecs appelaient déjà un savoir structuré (l’Epistēmē, la racine de notre « science » moderne), il aurait eu le mot pour le faire. Il aurait pu dire à Timothée de se méfier de la « fausse Epistēmē« .
Mais il ne le fait pas. Il choisit délibérément le mot Gnōsis. Ce choix n’est pas anodin ; il est même fondamental.
Paul ne critique donc pas la connaissance intellectuelle en soi, ni l’exploration rationnelle du monde. Ce verset ne vise pas non plus à distinguer au sein de l’activité scientifique une vraie science d’une fausse comme on l’entend parfois (nous reviendrons en détail sur ce point dans notre dernier article). Il vise une menace bien plus spécifique et dangereuse pour la jeune Église de l’époque : une doctrine spirituelle naissante qui deviendra plus tard connue sous le nom de… Gnosticisme.

Le Gnosticisme : Une « connaissance » qui déforme la foi
Le terme « Gnosticisme[2] » vient directement du mot gnōsis. Bien que le mouvement ne soit pas encore parfaitement formalisé, ses idées font déjà polémiques dans l’Eglise naissante. Utiliser ce mot précisément, c’est désigner l’adversaire par son nom, ou du moins par l’idée maîtresse qu’il promeut.
Le Gnosticisme n’était pas un mouvement unique et bien organisé, mais plutôt un ensemble de courants de pensée spirituels et religieux très divers, qui prenaient de l’ampleur dans le monde gréco-romain. Leur point commun ? Ils prétendaient tous offrir le salut, non pas par la foi ou la grâce, mais par une connaissance (gnōsis) secrète et supérieure, réservée à une élite d’initiés.
Pour les gnostiques, cette gnōsis n’était pas le fruit de l’étude, de la raison ou de l’observation (l’Epistēmē). Non, c’était une révélation mystique, intérieure, quasi magique, qui permettait d’atteindre une compréhension « supérieure » de Dieu et du monde.
Cette « connaissance » mystique enseignait des idées bien éloignées du christianisme naissant :
- Le monde matériel est mauvais : Pour les gnostiques, notre corps, la nature, tout ce qui est visible et tangible, était intrinsèquement mauvais. Il aurait été créé par une divinité inférieure, imparfaite, appelée le Démiurge (souvent assimilée au Dieu de l’Ancien Testament). Le vrai Dieu était, lui, un être pur, lointain et totalement étranger à ce monde défectueux.
- Des étincelles divines en prison : Ils croyaient que des fragments, des « étincelles divines », du vrai Dieu étaient tombés dans la matière et se retrouvaient emprisonnés dans les corps de certains humains (les « spirituels »).
- Le salut par la connaissance : Le salut consistait à libérer cette étincelle divine de sa prison corporelle, non par le sacrifice de Jésus sur la croix, mais par l’acquisition de cette gnōsis secrète. Jésus était souvent vu comme un simple messager, un « révélateur » de cette connaissance, et non comme le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité pour le salut du monde.
En qualifiant cette gnōsis de « faussement nommée » (en grec pseudōnymos), l’auteur de l’épître à Timothée fait plus que de la critiquer ; il l’annule ! Il affirme que cette prétendue connaissance supérieure, présentée comme la voie du salut, n’est en réalité qu’une imposture, une contrefaçon trompeuse. Elle se pare du noble nom de « connaissance », mais n’en est pas.
On comprend également beaucoup mieux les écrits de Jean dans le Nouveau Testament quand on dispose de cet arrière plan historique qui concerne le mouvement gnostique.
Les implications profondes de cet avertissement
Comprendre cette distinction change radicalement le sens du verset :
- Un avertissement ciblé, pas un rejet de l’intelligence : Le passage de 1 Timothée n’est absolument pas un appel à se méfier de la raison ou de la démarche scientifique. C’est une mise en garde pastorale très ciblée contre un mouvement théologique spécifique qui menaçait de dévoyer les croyants et de pervertir le sens même de la « connaissance de Dieu ».
- La vraie connaissance est le « dépôt » de la foi : Paul n’oppose pas la « fausse gnōsis » à l’ignorance. Il l’oppose au « dépôt » (parathēkē) que Timothée doit garder. Ce « dépôt » est un terme fort, comme un trésor confié à quelqu’un ou à une banque. Comme nous l’avons vu, Il représente la foi qu’il a reçue. Il renvoie aussi à un ensemble d’enseignements publics, clairs, transmis par les apôtres du premier siècle, fondés sur les événements historiques de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. La vraie connaissance chrétienne n’est pas une révélation mystique réservée à quelques élus, mais une relation personnelle (gignosko, la racine de gnōsis dans son sens positif) avec Dieu, rendue possible par la révélation en Christ. C’est une connaissance qui transforme le cœur, pas seulement l’esprit.
- Une défense de la Création et de Dieu : Certains commentateurs ont noté qu’en rejetant la gnose, Paul défend des points fondamentaux de la foi chrétienne qui sont directement attaqués par les idées gnostiques :
- La bonté de la création matérielle : Contrairement aux gnostiques qui voyaient le monde physique comme mauvais, le christianisme affirme que Dieu a créé le monde et l’a trouvé « très bon » (Genèse 1:31). Notre corps n’est pas une prison, mais un temple de l’Esprit Saint.
- L’unicité et la bienveillance de Dieu : Le gnosticisme introduisait des divinités inférieures et un Dieu lointain. Le christianisme proclame un seul Dieu, Créateur tout-puissant et aimant, qui s’est incarné en Jésus pour nous rejoindre dans notre réalité matérielle.
- Le salut universel : La gnōsis gnostique était élitiste. Le salut offert par la foi en Jésus est ouvert à tous, sans distinction, et est accessible par une foi simple, non par une « connaissance » secrète.
Conclusion : La foi et l’intelligence comme des alliées
L’analyse contextuelle de 1 Timothée 6:20-21 nous montre que l’auteur combat une spiritualité déviante, une sorte de « connaissance spirituelle » contrefaite qui éloignait les gens de la vraie foi en Jésus-Christ. Il ne dénonce pas la connaissance intellectuelle, la logique ou la science au sens moderne du terme.
Bien au contraire, la Bible encourage la recherche de la sagesse et de la compréhension. La vraie « connaissance » biblique n’est pas une formule secrète, mais une relation vivante avec un Dieu révélé, un Dieu qui a créé un monde ordonné et intelligible, que la science peut explorer.
Cet article d’Alister McGrath est un bref rappel sur la complémentarité essentielle entre science et foi.

Dans notre troisième et dernier épisode, nous pousserons l’analyse un peu plus loin.
Car ce verset sert souvent de prétexte pour affirmer que dans la science moderne il y aurait en quelque sorte deux sciences, une vraie, neutre ou en accord avec l’évangile et une fausse (comme la théorie de l’évolution) qui menacerait la foi chrétienne.
En plus des arguments déjà développés ici, nous verrons par la pratique en examinant certains commentaires modernes de ce verset, quels types de biais se cachent dans leurs interprétations.
Chacun disposera alors des éléments suffisants pour faire le choix de lecture qu’il juge le mieux approprié.
Restez connectés pour la conclusion de notre enquête !
[1] Les épîtres pastorales désignent un ensemble de trois lettres du Nouveau Testament attribuées à l’apôtre Paul : les deux épîtres à Timothée et celle à Tite. Elles sont qualifiées de « pastorales » parce qu’elles s’adressent à des responsables d’Églises locales (des pasteurs) pour les conseiller sur des questions pratiques : la manière de structurer la communauté, de réfuter les fausses doctrines et d’enseigner une vie chrétienne cohérente.
RQ: certains historiens les considèrent comme l’œuvre d’un disciple de Paul écrivant après sa mort plutôt que de Paul lui-même.
[2] Pour en savoir plus sur ce mouvement complexe, vous pouvez consulter l’article en ligne en français dédié au Gnosticisme sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gnosticisme
crédit illustrations : images générées par IA (Adobe Firefly / Google Imagen)
3 Articles pour la série :
la Bible est-elle contre la science ? Ce que 1 Timothée 6:20 nous révèle vraiment
- 1Ti 6.20, la Bible est-elle contre la science ? (1/3) Science et connaissance : ce que dit le Nouveau Testament ?
- 1 Ti 6.20, la Bible est-elle contre la science ? (2/3) Le mystère de la « fausse Gnose »
- 1 Ti 6.20,La Bible contre la science ? (3/3) : Le glissement rhétorique de la « fausse science »