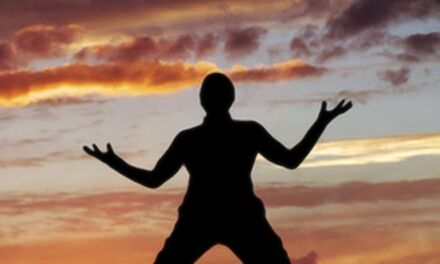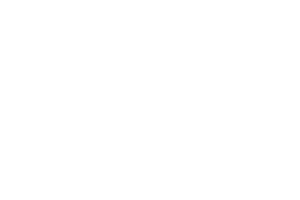Résumé
Cet article explore un débat édifiant entre science, psychanalyse et foi : la religion est-elle une simple construction psychologique ou un lien authentique avec Dieu ?
À partir des études scientifiques sur la prière — dont les résultats sont controversés — nous découvrons comment Freud voyait la religion comme une « névrose collective » nourrie par le besoin d’un père protecteur. En contrepoint, Paul Ricœur nuance cette vision, montrant que la foi, loin d’infantiliser, peut libérer de cette dépendance. L’exemple biblique de Job illustre cette foi mature, capable d’aimer Dieu sans attendre de récompense. Un texte qui invite à dépasser les clichés pour réfléchir à la différence entre religion et foi authentique.
La prière : que disent vraiment les études scientifiques ?
Beaucoup d’études scientifiques se sont intéressées sur la mesure de l’efficacité de la prière, le plus souvent dans sa capacité à parvenir à la guérison. Parfois ces études ont été commandées par des organismes religieux où en lien avec eux. Les résultats convergent pour affirmer qu’il n’a pas été possible d’établir un lien quelconque entre la prière et une amélioration de la santé. En revanche, les bénéfices psychologiques et neurologiques semblent plus probants, notamment en matière de réduction du stress et d’amélioration du bien-être[1].
Des conclusions controversées et un fondement scientifique remis en question
Certains athées ont pu exploiter ces résultats de recherche sur la prière pour alimenter leur argumentaire contre la religion[2]. Toutefois, de nombreux chercheurs et théologiens ont souligné que le fondement scientifique de ce type de recherches est souvent contesté, et qu’il est encore plus fragile lorsqu’on prétend en tirer des conclusions sur l’existence ou la nature de Dieu lui-même.
Quand science et foi se confrontent : le débat de fond
Ce que je voulais partager avec vous à cette occasion, c’est une discussion entre Ricoeur et Freud qui s’inscrit dans le débat de fond entre science et foi lié à ce sujet, à savoir : « après tout, la religion ne renvoie à rien d’autre qu’à une expérience psychologique, Dieu n’est rien d’autre qu’une vue de l’esprit, il ne fait pas partie du réel, mais de l’imaginaire des humains. »
Freud : la religion, une « névrose collective »
Car cette idée n’est pas récente, en effet pour Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, la religion s’apparente à une « névrose collective« . La névrose est un trouble psychologique issu d’un conflit inconscient. Ce conflit oppose des désirs ou pulsions profondes à des interdits moraux ou sociaux intériorisés. Ces désirs, jugés inacceptables, sont refoulés hors de la conscience. Mais ils continuent d’agir en sous-main et reviennent sous forme de symptômes : anxiété, obsessions, phobies, rituels compulsifs… Ces comportements procurent un soulagement temporaire, sans résoudre la cause profonde. Freud applique ce modèle à la religion et la considère comme une névrose collective[3].
Dieu comme figure paternelle idéalisée selon Freud
Selon lui, la figure de Dieu fonctionne comme une projection idéalisée du père. Dans l’enfance, le père (ou la figure parentale) est celui qui protège, pourvoit à tous les besoins et fixe les règles. L’enfant, fragile et dépendant, trouve en lui un refuge face aux dangers et à l’inconnu.
À l’âge adulte, selon Freud, ce besoin de protection et de sécurité ne disparaît pas : il se déplace vers la figure divine. Dieu devient alors un « Père céleste » tout-puissant, capable de subvenir à tous nos besoins, de nous défendre contre le mal et de nous promettre justice et consolation au-delà de la mort. Les croyances religieuses — comme la providence, le pardon ou la vie éternelle — répondent à ce désir infantile d’un parent parfait, toujours présent et bienveillant.
Les rituels religieux vus par la psychanalyse freudienne
Les rituels religieux (prières, confessions, etc.) sont, dans cette perspective, comparables aux rituels obsessionnels d’une névrose : ils apaisent l’angoisse, réaffirment le lien avec ce « père protecteur » et renforcent l’idée que l’on est sous sa garde.
Ainsi, pour Freud, la religion soulage l’angoisse existentielle en prolongeant dans la vie adulte la relation de dépendance et de confiance absolue envers un père — mais elle le fait au prix d’un attachement à une illusion, qui empêche d’affronter pleinement la réalité.
Paul Ricœur : un dialogue critique avec Freud
Paul Ricœur, philosophe protestant, est à la recherche d’un équilibre dans son dialogue avec la psychanalyse freudienne. Lors d’une de ses conférences consignée dans un recueil[4], il a exposé son refus d’une position qui rejetterait la psychologie au nom d’une opposition, ou de la recherche d’une continuité entre psychologie et le donné biblique. Ce qu’il propose, c’est de montrer l’intérêt à considérer la psychologie et le langage biblique dans deux registres séparés ayant leur propre référentiel et permettant de comprendre l’enfance sous des angles différents. Finalement, les chrétiens ne devraient pas craindre la psychologie dont un bon usage peut être défini En effet pour Ricœur, Freud jette pour ainsi dire, le bébé avec l’eau du bain lorsqu’il accuse la religion d’être « source de névrose » (p. 64).
Pour approfondir la pensée de Ricœur, nous explorerons également son ouvrage De l’interprétation essai sur Freud, où Ricœur poursuit son analyse de la psychanalyse de Freud[5].
Ricœur, à partir de sa lecture de Totem et Tabou de Freud montre comment celui-ci concevait la religion comme une certaine forme d’infantilisation.
C’est le sens même de la détresse de l’adulte, en tant qu’elle continue et répète la détresse infantile ; l’homme est « destiné à demeurer à jamais un enfant » ; alors il investit les puissances inconnues et redoutables des traits de l’image paternelle. Telle est l’interprétation spécifiquement psychanalytique de la religion : son sens « caché » est la répétition sempiternelle de la nostalgie du père [6].
L’infantilisation religieuse, une idée à nuancer
Comme nous l’avons indiqué, Ricœur ne rejette pas d’un bloc l’approche de Freud, il cherche à faire la part des choses. Ainsi il reconnaît par exemple l’apport de la psychanalyse pour comprendre l’impact des traumatismes de la petite enfance à l’âge adulte :
Il y a une leçon que nous devons retenir de la psychanalyse : ce sont les toutes premières blessures qui sont les plus graves, parce que la vie réactivera sans cesse ces premières (p. 61).
De la même manière, il entend Freud, quand il lui dit que la religion renvoie à l’image du père qui console, qui peut tout et qui encouragerait un comportement infantilisant. Car pour Freud,
tout s’organise, on le sait, autour du noyau paternel, de la nostalgie du père. La religion est fondée biologiquement dans la situation de dépendance et de détresse qui caractérise la seule enfance humaine[7].
Or, pour Ricœur, l’amalgame de Freud entre religion et infantilisation va trop loin. Ricœur est cependant reconnaissant envers Freud, car il est bien conscient du risque des effets qu’une relation avec un Dieu qui ne serait que le reflet de notre égo fantasmé pourrait avoir. Il confie :
Je ne cache pas que c’est la lecture de Freud qui m’a aidé à pousser la critique du narcissisme […] qui m’a aidé à porter au cœur de la problématique de la foi le « renoncement au père »[8].
Non pas bien sûr que Ricœur ait renoncé à Dieu comme Père, mais cette expression renvoie à celle de Freud, d’une réalité débarrassée du complexe du père. Pour Freud, comme nous l’avons vu, la religion fabrique l’image d’un père infantilisant qui satisferait toujours et à tous nos besoins (qui répondrait inconditionnellement à toute nos prières pour reprendre le sujet de notre introduction). Si pour Freud, le Dieu des religions — et le Dieu chrétien — est ce père, là, pour Ricœur, le Dieu biblique n’y ressemble pas. Un premier exemple est donné par Ricoeur avec la contestation de Paul de certains rudiments de l’enfance, mais le point que nous allons développer est celui qui s’appuie sur Job.
Job : un exemple de foi qui dépasse la religion
Ricœur donne en effet l’exemple de Job pour montrer en quoi Freud n’a pas su discerner entre ce qui relève de la religion et de la foi.
Il faut entrer dans une autre problématique, que le freudisme ne paraît pas avoir conçue, celle du conflit interne entre foi et religion […]. Cette foi accomplit quelque chose de la tâche que Freud assigne à quiconque entreprend de « renoncer au père » […] Job, en effet, ne reçoit aucune explication concernant sa souffrance ; il lui est seulement montré quelque chose de la grandeur et de l’ordre du tout, sans que le point de vue fini de son désir en reçoive directement un sens. [9].
CONLUSION : Foi ou illusion ? La mise en garde de Ricœur contre l’idolâtrie
C’est la foi de Job qui lui a permis d’aimer Dieu gratuitement et d’accomplir le geste même que Freud reconnaît comme un « renoncement au père » dans lequel se reconnaît également Ricœur. La religion peut produire un comportement infantilisant, Ricœur sera ainsi d’accord avec Freud, mais la foi l’en délivre. Ricœur échappe donc à l’amalgame freudien d’une religion infantilisante source de névrose, mais il garde de Freud le danger de se fabriquer sa propre idole pour répondre à des comportements infantilisants qui nous guettent toujours.
Notes
[1] L’étude STEP (Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer) en 2006, financée notamment par la fondation Templeton, n’a mis en évidence aucune différence significative dans la récupération des patients opérés du cœur, selon qu’ils étaient ou non l’objet de prières ; https://www.templeton.org/news/what-can-science-say-about-the-study-of-prayer
Une méta-analyse de 2006 (14 études) conclut qu’il n’y a « aucun effet discernable », tandis qu’une revue de 2007 (17 études) observe des effets « petits mais significatifs » dans 7 cas, mais note que les études les plus rigoureuses ne montrent aucun effet https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_health
[2] Voir par exemple cette discussion sur Redit :
https://www.reddit.com/r/atheism/comments/1cvx4yq/has_there_been_any_scientific_study_on_the/
[3] Freud, L’Avenir d’une illusion (1927)
[4] Voir Paul RICŒUR, « Vivre en adultes comme des enfants », Jeunes femmes 4, 1965, p. 61-71.
[5] Paul Ricœur, De l’interprétation essai sur Freud, Paris, Éditions du Seuil, édition numérique Kindle, 1965.
[6] Ibid., LII, chp III.3, empl. 5606.
[7] Ibid., LIII, chp IV.5, empl. 11697.
[8] Ibid., LIII, chp IV.5, empl. 12024.
[9] Ibid., LIII, chp IV.5, empl. 11996.