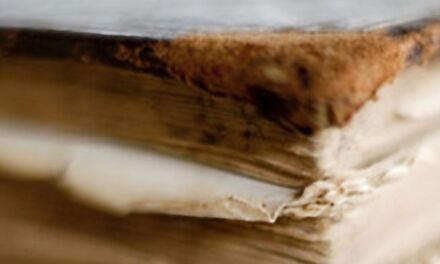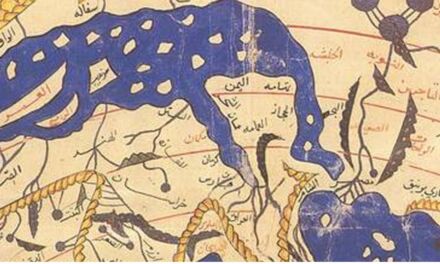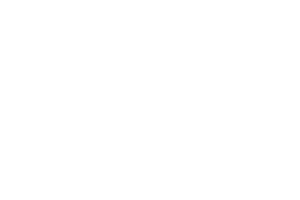crédit illustration : depositphotos
Archéologie et histoire biblique
L’archéologie de Jérusalem a toujours été l’épicentre de l’archéologie biblique en raison de sa cruciale importance pour la compréhension des larges perspectives de l’histoire biblique.
Israël Finkelstein
Ainsi Israël Finkelstein, célèbre archéologue israélien, introduisait-il en 2012 une communication sur l’archéologie et l’histoire de Jérusalem [1] dans laquelle il situait l’essor du royaume de Juda du milieu du IXème au milieu du VIIIème siècle avant J-C, sur la base des évidences collectées en 150 ans d’exploration archéologique. Un essor aussi tardif est incompatible avec la thèse biblique d’une grande monarchie unifiée au Xème siècle avant Jésus-Christ.
Est-ce que Jérusalem était déjà une zone urbaine développée ou seulement un village du temps des premiers rois de Juda ?
Derrière cette question en apparence simple se cache un véritable casse-tête pour un archéologue. L’occupation continue sur plus de 4 000 ans a conduit Jérusalem à être un amalgame de constructions de différentes périodes ; c’est une ville qui a connu de nombreuses guerres, destructions et reconstructions, se transformant en zones urbaines tentaculaires et complexes construites sur les ruines de ce qui l’avait précédé.
L’intérêt dune chronologie absolue en archéologie
Malgré tout ce qui a été écrit sur Jérusalem, l’étude de son âge du fer s’est donc avérée un défi en termes de chronologie absolue.
L’âge du fer est une période archéologique caractérisée par la métallurgie du fer et faisant généralement suite à l’âge du bronze, dans la tradition historique européenne. Toutefois, les limites chronologiques de l’âge du fer varient considérablement selon l’aire culturelle et géographique considérée. Il débute vers 800 à 700 av. notre ère en France alors que dans la chronologie traditionnelle du Proche-Orient ancien, il s’étend d’environ 1200 à 333 av. J.-C. Une chronologie absolue implique de déterminer les dates ou périodes exactes auxquelles appartiennent les preuves archéologiques, par opposition à une chronologie relative, qui établit l’ordre des événements sur la base des similitudes avec des preuves architecturales ou céramiques d’autres sites.
Une chronologie absolue enfin disponible pour dater des vestiges de Jérusalem
Une étude tout récemment publiée dans la prestigieuse revue américaine PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) propose une datation absolue pour des vestiges de la période du premier temple à Jérusalem, construit selon la Bible au Xème siècle avant J-C par Salomon et détruit par les Babyloniens en 586 avant J-C [2]. Conduite par des chercheurs de l’Institut des sciences Weizmann, cette étude repose sur les techniques de datation au radiocarbone et de dendrochronologie auxquelles nous avons récemment consacré un article sur le site Science et Foi [3].
Les obstacles rencontrés
A la complexité induite par les réaménagements continus de la ville s’ajoute une difficulté supplémentaire liée aux propriétés de la courbe de calibration radiocarbone pour la période comprise entre le VIIIe et le Ve siècle avant notre ère. Cette courbe présente une zone constamment plate sur des graphiques qui tracent la datation au radiocarbone par rapport aux dates du calendrier. Cette zone a été baptisée plateau de Hallstatt, du nom de la période culturelle de Hallstatt en Europe centrale avec laquelle il coïncide.
Certains archéologues qualifient le plateau de Hallstatt de « catastrophe radiocarbone du 1er millénaire avant JC » car elle rend très difficile de résoudre les dates au radiocarbone de tout échantillon dont l’âge réel se situe entre 400 et 800 avant JC. En conséquence, les archéologues explorant Jérusalem à l’âge du fer se sont davantage appuyés sur des textes bibliques et historiques et sur l’étude de la poterie plutôt que sur la datation au radiocarbone.
Comment les chercheurs de Weizmann s’y sont-ils pris pour franchir cet obstacle ?
L’avènement de la microarchéologie
Ils ont utilisé des approches de microarchéologie, un domaine relativement nouveau des sciences archéologiques. Cette approche se concentre sur l’examen minutieux des éléments de preuve laissés sur les sites, à l’aide d’instruments scientifiques avec un niveau de soin et d’attention presque médico-légal. En se rendant sur les sites de fouilles de Jérusalem, les chercheurs ont pu effectuer plus de 100 mesures au radiocarbone sur des matières organiques, principalement des graines carbonisées.
Après séparation du matériau d’origine des contaminants, ils ont effectué plusieurs mesures de radiocarbone au laboratoire de spectrométrie de masse par accélérateur de recherche Dangoor (D-REAMS) de Weizmann afin d’obtenir le plus haut niveau d’exactitude et de précision en matière de datation.
Croisement des données avec d’autres techniques de datation
Les datations ainsi obtenues ont été confrontées aux informations fournies grâce à 100 cernes d’arbres datés par calendrier et provenant d’archives bien connues. Cette confrontation a permis de mettre en évidence les fluctuations du pourcentage de carbone 14 dans l’atmosphère au cours de la période d’intérêt, ce qui a également contribué à affiner une chronologie absolue.
L’existence de deux événements historiques survenus à des dates bien établies – la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant notre ère, et le tremblement de terre du 8ème siècle avant notre ère et les vastes efforts de reconstruction qui ont suivi – ont contribué à mieux comprendre le comportement du radiocarbone dans l’atmosphère. Les chercheurs ont remarqué des différences entre le radiocarbone présent dans le matériau de la région et la concentration mesurée dans les cernes des arbres européens et américains à la même époque. Ces différences – lorsque les données radiocarbones ne correspondent pas à ce que nous savons qu’elles devraient être grâce aux cernes des arbres – sont connues sous le nom de « compensations », et leur compréhension peut être d’une importance fondamentale pour les scientifiques qui étudient le climat et l’atmosphère, ainsi que pour les scientifiques.
Les résultats
Un des résultats principaux de l’étude est la preuve concrète de la présence généralisée d’habitations humaines à Jérusalem dès le 12ème siècle avant notre ère, trois siècles plus tôt que ne suggérait Israël Finkelstein dans son article de 2012 [2]. Cela infirme l’hypothèse conventionnelle selon laquelle la ville s’était agrandie en raison de l’arrivée de réfugiés du Royaume d’Israël au nord, suite à l’exil assyrien. Une expansion de la ville vers l’ouest a été précisément datée du 9ème siècle avant notre ère en déterminant le moment de la construction d’un grand bâtiment ancien. Ainsi Jérusalem se serait agrandie et étendue vers le mont Sion dès cette époque, sous le règne du roi Joas, cent ans avant l’exil assyrien.
Les méthodes développées dans l’étude pourraient avoir un impact au-delà de Jérusalem, car les problèmes liés à l’utilisation de la datation au radiocarbone sur les sites de l’âge du fer constituent un problème mondial. L’approche microarchéologique de l’équipe peut être utilisée sur bon nombre de ces autres sites, contribuant ainsi à combler les lacunes de cette période charnière du développement humain et de l’histoire.
conclusion
En conclusion, les perspectives ouvertes par cette étude sont considérables parce que la méthodologie utilisée permet pour la première fois d’envisager une datation absolue des sites archéologiques du Moyen-Orient à l’âge de fer qui soit basée exclusivement sur les sciences exactes, en complément des chronologies relatives basées sur des textes historiques et sur l’étude de la poterie. Appliquée à l’expansion antique de Jérusalem à l’époque du 1er temple, elle remet en question la chronologie traditionnellement admise et permet de faire émerger une image plus complète et plus précise de Jérusalem pendant le royaume de Juda et les périodes qui l’ont précédé.
Références
[1] Finkelstein Israel. L’archéologie et l’histoire de Jérusalem (1000-700 av. J.-C.) . In: Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 156e année, N. 2, 2012. pp. 827-858. DOI : https://doi.org/10.3406/crai.2012.93578
www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2012_num_156_2_93578
[2] Regev J, Gadot Y, Uziel J, Chalaf O, Shalev Y, Roth H, Shalom N, Szanton N, Bocher E, Pearson CL, Brown DM, Mintz E, Regev L, Boaretto E. Radiocarbon chronology of Iron Age Jerusalem reveals calibration offsets and architectural developments. Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 May 7;121(19):e2321024121. doi: 10.1073/pnas.2321024121. Epub 2024 Apr 29. PMID: 38683984.
[3] https://scienceetfoi.com/peut-on-faire-confiance-aux-methodes-de-datation-geologique/